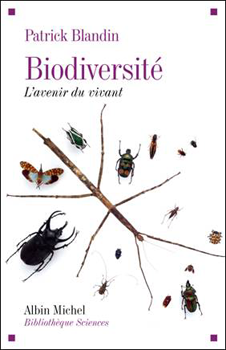[dropcap]M[/dropcap]on engagement dans le domaine de la conservation de la nature s’est nourri d’expériences diverses, entre autres : un travail sur les bioindicateurs et sur l’ingénierie ou « génie » écologique ; ma participation, à partir de 1983, à l’inventaire des « ZNIEFF » (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique », en tant que responsable scientifique de cet inventaire pour la Région Ile-de-France (télécharger la publication n°88 bis BLANDIN & CHASTEL 1987) ; mon implication dans les problèmes de la forêt de Fontainebleau ; l’expertise de l’impact de l’autoroute A28, près du Mans, sur le coléoptère Pique-Prune.
En 1992, j’ai été sollicité pour conduire, au nom du Muséum, la création du Comité Français de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), comité que j’ai présidé jusqu’en 1999. A ce titre, j’ai participé au comité international d’organisation du cinquantenaire de la création de l’UICN, célébré en 1998 à Fontainebleau. Quelques années plus tard, avec François Moutou, j’ai lancé l’idée que l’UICN devrait se doter d’un « code éthique pour la conservation de la biodiversité », idée qui a été à l’origine de la « Biosphere Ethics Initiative », que l’UICN a lancé en 2010, à l’occasion de l’année internationale pour la biodiversité.
J’ai développé ma réflexion sur la conservation de la nature, appuyée sur des recherches historiques, dans deux ouvrages récents : De la protection de la nature au pilotage de la biodiversité (Editions Quae, 2009, Publication 211) et Biodiversité, l’avenir du vivant (Albin Michel, 2010) qui a reçu plusieurs prix.
Bioindicateurs et génie écologique
En 1977, avec mon équipe de la Station Biologique de Foljuif, j’obtins un financement du ministère de l’environnement, dans le cadre d’un appel d’offres pour la mise au point d’indicateurs biologiques de l’état des écosystèmes terrestres. Notre objectif était de rechercher des indicateurs biologiques de l’impact de la fréquentation sur les sols des forêts périurbaines. La mise en évidence de modifications qualitatives et quantitatives de la faune d’invertébrés dans les sols piétinés permit d’envisager la définition d’indices de perturbation (Publications 59, 60, 64, 68, 69, 74). Ces résultats préliminaires ont été ultérieurement testés et affinés expérimentalement (Publication78) et la mise au point d’indicateurs à la fois sensibles et robustes analysée de façon critique (Publication86).
Le ministère de l’environnement me confia en 1982 l’élaboration d’une synthèse sur la conception et l’utilisation de bioindicateurs permettant de caractériser l’état et les transformations des écosystèmes. Publié en 1986, ce travail m’a valu en 1987 le Prix Foulon d’économie rurale de l’Académie des Sciences (Publication86). Précédemment, j’avais écrit, avec Maxime Lamotte, dans l’ouvrage Fondements rationnels de l’aménagement d’un territoire, un chapitre, à la fois théorique et méthodologique, dans lequel nous avions introduit le concept d’écocomplexe, ensemble d’écosystèmes interactifs issus d’une histoire commune, naturelle et humaine (Publication72).
A la suite d’une commande du ministère de l’environnement, j’ai poursuivi en 1989 la réflexion sur l’évaluation, à l’aide de bioindicateurs, de « l’état de santé des écozones », terme désignant un territoire ayant une certaine unité, structurale et fonctionnelle, du point de vue écologique (Publication 95). Au début des années 90, la biodiversité étant devenue à la mode, la question s’est posée de la mise au point d’indicateurs de biodiversité ; j’ai notamment travaillé cette question, qui pose de difficiles problèmes théoriques, à la demande de l’Office National des Forêts (Publication 128).
En 1983, le Secrétariat Faune Flore du Muséum, qui lançait l’inventaire « ZNIEFF » (Zones d’Intérêt Ecologique, Faunistique, Floristique) m’avait demandé de diriger cet inventaire pour la Région Ile-de-France. Dans ce contexte, j’ai participé à un colloque sur l’utilisation des invertébrés pour l’évaluation des espaces patrimoniaux (Publication 98). J’ai ensuite participé aux réflexions nationales sur l’évolution de l’inventaire ZNIEFF (Publication 103) et, plus tard, sur le zonage des milieux naturels (Publication 152).
Parallèlement, en 1983-1984, j’ai été membre du groupe de travail dirigé par l’économiste Claude Henry, chargé par le ministre de l’environnement d’une mission de propositions sur la recherche et la formation en vue de la « maîtrise écologique du territoire ». Nous avons notamment travaillé sur la notion de « génie écologique » et sur la formation des ingénieurs écologues. En 1988, j’ai été nommé membre de la commission d’évaluation du Département Montagne du CEMAGREF, ce qui m’a conduit à analyser les activités d’ingénieurs et de chercheurs en « génie écologique ». En 1990, avec l’Ingénieur Général Jean Dunglas, j’ai été chargé par le ministre de l’environnement d’une mission de prospective sur le « génie écologique » (Publications113, 118, 121). Dans le cadre de cette mission, j’ai visité des « réserves naturelles » en Angleterre, parfois très manipulées, par exemple pour favoriser la présence et la visibilité de certaines espèces d’oiseaux, comme l’Avocette. Je retrouvais là, poussé à la caricature, le concept de « réserve dirigée », espace où l’on intervient pour maintenir des espèces que la dynamique naturelle pourrait éliminer.
Dès les années 1980, la conservation de la nature était pour moi une dimension de la gestion intégrée de territoires individualisés, accordant toute son importance à la nature ordinaire (Publication 86). Dans ce contexte, la problématique de la « bioévaluation », à l’aide de bioindicateurs, prenait une double dimension : comment évaluer l’écart entre l’état d’un système écologique « modifié » et son état « normal » ; comment évaluer la modification de l’adaptabilité d’un système écologique du fait de sa transformation anthropique. Ma réflexion sur la notion de trajectoire des systèmes écologiques, notion qui relativise fortement celle « d’état de référence », confortée par mon travail sur le génie écologique et par les recherches que j’ai animées sur les îlots boisés à partir de 1992 (Publications 139, 145, 195), a renforcé l’idée que la conservation de la nature doit s’inscrire dans une perspective dynamique, évolutionniste, dimension dont j’avais compris l’importance à la lecture de l’ouvrage Conservation and Evolution d’Otto Frankel et Michael Soulé (1981). C’est ce que j’ai développé dans mon livre De la protection de la nature au pilotage de la biodiversité (Editions Quae, 2009, Publication211).
Gestion forestière et conservation de la nature
Au début des années 1980, je fus nommé membre de la commission consultative des réserves biologiques de la forêt de Fontainebleau, au titre de ma direction de la Station Biologique de Foljuif. Ce fut pour moi une première occasion d’être confronté à des problèmes concrets de conservation. En 1989 – entre temps, j’avais été nommé Professeur d’Écologie Générale au Muséum –, le Professeur Jean Dorst fut sollicité par l’Office National des Forêts (ONF) pour réfléchir, avec un groupe de collègues du Muséum, à l’avenir de la forêt de Fontainebleau. Jean Dorst me demanda d’être rapporteur de la commission qu’il avait constituée. Dans notre rapport, nous avons préconisé la création d’une Réserve de Biosphère (programme MAB – Man and Biosphere – de l’UNESCO) (Publication109). Nous pensions en effet que ce cadre, non réglementairement contraignant (à la différence d’un Parc National), serait propice au développement d’un projet mobilisant les acteurs du territoire.
A la suite de notre rapport, L’ONF ayant décidé de mettre en œuvre un nouveau plan d’aménagement de la forêt de Fontainebleau, j’ai eu la responsabilité d’une étude sur les écosystèmes rares et remarquables de la forêt, en vue d’une redéfinition des réserves biologiques domaniales (Publication 148). Ce travail a contribué à l’augmentation des réserves intégrales et à la création de nouvelles réserves dirigées. Sous l’impulsion de l’ONF, la Réserve de Biosphère a été officiellement créée en 1998, à l’occasion du Cinquantenaire de la création de l’UICN, célébré à Fontainebleau. J’ai été Président du Comité scientifique de la Réserve de Biosphère du Pays de Fontainebleau de 2003 à 2006.
A la suite du travail de la Commission Jean Dorst, j’ai proposé à l’ONF qu’une convention soit passée avec le Muséum pour constituer un cadre formel à de nouvelles collaborations, qu’il s’agisse d’expertises ou d’études. Dans ce contexte, j’ai été consulté par l’ONF pour l’élaboration d’une instruction sur la prise en compte de la diversité biologique dans l’aménagement et la gestion forestière, n°93 T 43, publiée en 1993. J’ai également été chargé d’une mission combinant expertise et médiation en forêt de Tronçais, où l’ONF avait fixé un plan de chasse drastique en raison des dégâts qu’en particulier les cerfs provoquaient dans les parcelles en régénération. Ce fut pour moi une instructive expérience sociologique, en découvrant les jeux des acteurs, chasseurs, notables, protecteurs de la nature… Par ailleurs, L’ONF m’avait également confié une étude sur les indicateurs de biodiversité, qui a donné lieu à des mémoires d’étudiants et à une publication (Publication 128).
J’ai exprimé mon point de vue sur les relations entre gestion forestière et conservation de la nature dans diverses publications, insistant en particulier sur l’effet appauvrissant de la gestion classique, qui ne permet pas le vieillissement des arbres, leur sénescence et leur dégradation naturelle, étapes auxquelles est liée l’existence de nombreuses espèces (Publications 131, 132, 138, 142, 156, 183). D’où l’idée de prévoir en tout cas des « bouquets de vieillissement ». J’ai aussi participé à un ouvrage collectif de collègues du Laboratoire d’Ecologie Générale du Muséum. Cet ouvrage, coordonné par Pierre Arpin et publié par l’ONF, traitait de la diversité des invertébrés forestiers et de la gestion de cette diversité (Publication 167).
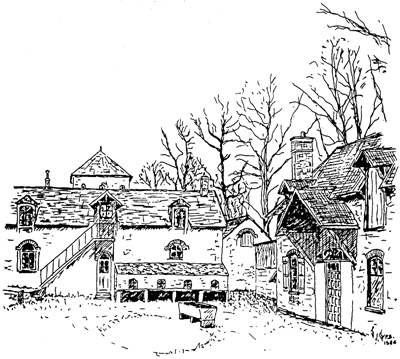
La Station Biologique de Foljuif
Autoroutes et patrimoine naturel
En 1990, j’ai fait partie d’un groupe d’experts, constitué à la demande du ministre chargé des transports, pour évaluer les diverses options envisagées pour le franchissement de la vallée de la Risle, près de l’Abbaye du Bec-Hellouin, par l’autoroute A 28 (Publication 102). Ou bien celle-ci passait à proximité immédiate d’une zone d’intérêt écologique, faunistique et floristique, avec d’éventuelles conséquences sur l’état de celle-ci, ou bien elle passait sur un viaduc s’inscrivant dans le paysage du Bec-Hellouin. Modification d’un patrimoine naturel, ou modification d’un patrimoine culturel ? Le groupe considéra qu’un paysage ne pouvait être figé, mais qu’en raison de la qualité de celui du Bec-Hellouin, il convenait que le viaduc soit conçu non seulement comme un ouvrage d’art, mais comme une geste artistique.
Sept ans plus tard, j’étais à nouveau confronté à l’A 28, cette fois dans la région du Mans, et pour une tout autre raison. En 1996, une larve d’une espèce de coléoptère – le Pique-Prune Osmoderma eremita – protégée par une directive européenne promulguée en 1992, fut découverte à proximité du tracé du tronçon Le Mans – Tours, dont la construction était imminente. Une étude d’impact s’imposait. Je connaissais un bureau d’études travaillant avec le concessionnaire de l’autoroute. Ce bureau d’études conseilla à celui-ci de solliciter le Muséum pour mener cette étude d’impact, sous ma responsabilité. Or j’avais dirigé la thèse de Jean-Marie Luce, soutenue en 1995, sur l’écologie de coléoptères en forêt de Fontainebleau, dont le Pique-Prune. On confia donc le travail de terrain à Jean-Marie Luce, pour une durée de 2 ans. Notre rapport fut rendu en 1999 (Publication159). La création de zones Natura 2000 était conseillée, mais nous soulignions que l’impact de l’autoroute serait probablement plus faible que celui des remembrements des parcellaires agricoles dans les communes traversées. En effet, le Pique-Prune était largement présent dans les chênes têtards plantés dans les haies. Il fut donc décidé l’élaboration d’un schéma directeur des remembrements, qui nécessita le diagnostic de toutes les haies du secteur et des quelque 17000 arbres susceptibles d’héberger le coléoptère. J’eus à valider le protocole de travail, puis les conclusions. Finalement, en 2002, à la demande de l’État, je rendis de dernières conclusions prenant en compte l’ensemble des mesures envisagées, au niveau de l’autoroute proprement dite et des remembrements. J’ai conclu que les impacts résiduels n’auraient pas de conséquence significative sur les populations du Pique-Prune (et de deux autres espèces, moins emblématiques, le Lucane Cerf-Volant, Lucanus cervus, et le Grand Capricorne, Cerambyx cerdo). L’autoroute a été construite.
Ces expériences m’ont fait réfléchir aux difficultés de l’expertise scientifique, et plus largement au rôle des scientifiques dans les problèmes de décision ayant des conséquences sur la biodiversité ; je suis intervenu sur ces questions dans une table ronde de la Conférence Internationale sur la Biodiversité (Paris, janvier 2005), et j’ai contribué à un chapitre de l’ouvrage collectif publié à l’occasion de cette conférence (Publications 174, 186, 189, 211).
A la suite de l’expertise de l’A 28, la Direction des Routes du ministère chargé de l’équipement et des transports a souhaité établir une convention de collaboration avec le Muséum. Dans ce cadre, avec mon collègue du Muséum Frédéric Jiguet, j’ai effectué une expertise de la prise en compte de la flore, de la faune et des milieux naturels dans les études d’impact de projets routiers et autoroutiers (Publication 188). J’ai également contribué à la conception du document La nature et la route, publié en mars 2004 par la Direction des routes, à l’intention des professionnels du secteur. J’ai ensuite été sollicité par la formation continue de l’Ecole des ponts pour participer, en 2006 puis en 2007, à une session de formation intitulée « Concilier les projets d’infrastructures linéaires avec le respect des milieux naturels (faune, flore et écosystèmes) », destinées à des personnels des services techniques de l’État, des collectivités territoriales et des entreprises.

Le Pique-Prune Osmoderma eremita
Agriculture et Biodiversité
J’ai été nommé le 2 avril 2007 par le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche, pour une durée de 3 ans, membre associé de la section 6 « Nature, Forêt, Paysage » du Conseil Général de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Espace Rural (CGAAER). J’ai contribué au rapport du CGAAER sur le plan d’action Agriculture de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité, (Publication 214). J’ai effectué une analyse critique de ce plan et avancé des propositions pouvant, selon le vice-président du CGAAER, « servir pour la doctrine d’action de notre ministère » (lettre au Directeur du cabinet du ministre de l’agriculture et de la pêche, 15 avril 2009).
Une conception évolutionniste de la conservation de la nature
A la lecture du livre de Otto Frankel et Michael Soulé « Conservation and evolution » (1981), j’acquis la conviction que la conservation de la nature ne pouvait être « fixiste », c’est-à-dire chercher à figer la nature dans un état supposé « idéal ». J’ai affirmé cette position dans ma contribution à l’article « Ecologie » de l’Encyclopaedia Universalis (Publication 73). En outre, en 1984, en définissant avec Maxime Lamotte l’écocomplexe comme un ensemble d’écosystèmes interactifs issus d’une histoire naturelle et humaine commune (Publication 72), nous affirmions notre conviction que les humains sont bien « dans la nature » et en orientent l’évolution. En arrière-plan, c’était l’idée qu’il n’y a pas la « Nature pure » d’un côté, et la Nature « dégradée » par l’Homme de l’autre, question que j’ai reprise ultérieurement avec le philosophe Donato Bergandi (Publications 162, 163, 175).
Mon travail sur les indicateurs biologiques (Publication 86), fut l’occasion de mettre en avant deux objectifs : le maintien des capacités d’autorégulation des systèmes écologiques et la préservation de leurs potentialités évolutives. Evoquant ce deuxième objectif, j’écrivais : « Le second élargit la perspective au long terme, en demandant que soit conservée la capacité d’adaptation, donc de changement des espèces et des systèmes écologiques. Sans doute des considérations scientifiques justifient-elles déjà cette orientation, mais il s’y ajoute des considérations éthiques. Comme le soulignent FRANKEL et SOULÉ (1981), les hommes ont une responsabilité vis-à-vis de la continuation du processus évolutif. ».
En 1989, le Directeur du Muséum me confia la responsabilité du commissariat scientifique du thème « Les relations Homme-Nature », qui devait être traité dans la Grande Galerie de l’Évolution. Le titre définitif qui fut choisi : « L’Homme, facteur d’évolution », illustre bien la perspective dynamique dans laquelle s’était placée l’équipe interdisciplinaire que nous avions constituée. En outre, nous nous étions emparés du néologisme « biodiversité », suite à la parution du livre « BioDiversity » en 1988 : nous avons orienté le propos de l’exposition sur la question du devenir et de la gestion de la biodiversité.
Par ailleurs, la recherche interdisciplinaire que j’ai animée avec Paul Arnould sur le devenir des îlots boisés – et de leur biodiversité – en plaine d’agriculture intensive (Publications 145, 195) confortait cette perspective dynamique, mettant en relief le concept de trajectoire des systèmes écologiques et de leur diversité. Ces expériences m’ont conduit à concevoir la conservation de la nature comme une gestion, un « pilotage » des systèmes écologiques ayant pour objectif leur adaptabilité durable, ce qui passe par une diversité aussi élevée que possible (Publications 180, 211, 218).
L’adaptabilité durable
Une conception évolutionniste de la conservation de la nature met l’accent sur la conservation des potentialités d’adaptation des espèces et des systèmes écologiques. Dans un ouvrage collectif sur les enjeux du développement durable (sous la direction de Patrick Matagne, L’Harmattan, 2005), j’ai avancé l’idée d’ « adaptabilité durable », entendant par là qu’il est essentiel de préserver sur le long terme les capacités d’adaptation du vivant (Publication 190). J’ai développé cette approche, en en explicitant les fondements, dans un entretien publié dans le premier numéro de la nouvelle revue « Vraiment durable », en soulignant l’enjeu éthique que représente le maintien, voire l’accroissement de l’adaptabilité du vivant (Publication 238 ).
La dimension éthique
En 1977, je m’étais inscrit aux « Entretiens Ecologiques de Dijon », une association créée par Georges Tendron (Sous-Directeur au Muséum, directeur du Service de la Conservation de la Nature) et Robert Poujade (maire de Dijon, qui fut le premier ministre en charge de la protection de la nature). J’ai participé au groupe de réflexion « Ecologie, Ethique et Spiritualité », animé par Jean-Pierre Ribaut, à l’époque en charge, au Conseil de l’Europe, de la protection de la nature. J’ai été ainsi sensibilisé à la dimension éthique des problèmes écologiques, la soulignant, sans aller plus loin, dans divers écrits, au cours des années 80-90 (Publications97, 112, 130). Cet intérêt a été renforcé par mes contacts avec des milieux catholiques, en particulier le mouvement Pax Christi, dont un groupe de réflexion sur les questions d’environnement était animé par Jean-Pierre Ribaut (Publications101, 104, 143, 169, 191). Il le fut également sous l’influence de la philosophe Catherine Larrère, auteur d’un ouvrage sur les éthiques environnementales (Les philosophies de l’environnement, 1997), et par mes discussions avec le philosophe Donato Bergandi.
Le travail de conception du thème « L’Homme, facteur d’évolution » de la Grande Galerie du Muséum, l’ouvrage d’accompagnement, « L’évolution », dont j’ai dirigé la rédaction, plus tard la direction du livre « Trésors de nature » et la conception de l’exposition temporaire « Nature vive » (2000-2001), dont j’ai partagé le commissariat scientifique avec Catherine Larrère, tout cela a contribué à la construction de mes idées sur les rapports des humains avec la nature, ceci d’autant plus que j’ai été associé, à partir de 1997, à une équipe d’anthropologues et d’ethnobiologistes du Muséum, associée au CNRS sous le titre « Appropriation et socialisation de la nature » (APSONAT).
En 1991, en pleine préparation du synopsis de la Grande Galerie de l’Evolution (GGE), j’avais donné une conférence au Conseil Général du Génie Rural, des Eaux et des Forêts des réflexions sur le thème : « Ecologie et évolution : les responsabilités des hommes », où je mis en relief la dimension éthique de la conservation de la nature (Publication 112 ), affirmée aussi, en 1996, dans le livre collectif « L’évolution », illustrant les thèmes de la GGE (télécharger un extrait de la Publication 136). Ce n’est qu’en 2004, cependant, que j’ai commencé à construire une réflexion sur la nécessité d’une éthique évolutionniste (Publication 180). Je l’ai poursuivie dans diverses publications (Publications, 190, 211), et je l’ai exprimée de façon plus complète en 2010 dans « Biodiversité, l’avenir du vivant ». Depuis, je l’ai présentée à diverses occasions (Publication 218 ; Prix littéraires), notamment dans le cadre des conférences du « Musée de l’Homme hors les murs », le 12 janvier 2012, ainsi que dans de nouvelles publications, soulignant que le devenir de la biodiversité constitue un enjeu éthique majeur (Publications 222, 224, 238, 239).
Parallèlement, dans le cadre de l’UICN, j’ai été avec François Moutou à l’origine d’un processus qui s’est concrétisé en 2010 par l’adoption par l’UICN de la « Biosphere Ethics Initiative » (BEI), ou « Initiative pour une Ethique de la Biosphère » (IEB), une démarche visant à développer la réflexion éthique au sein de l’Union, autour de valeurs et de principes offerts à la discussion. L’IEB a notamment influencé la rédaction du préambule de la nouvelle Stratégie Nationale pour la Biodiversité », adoptée en mai 2011.