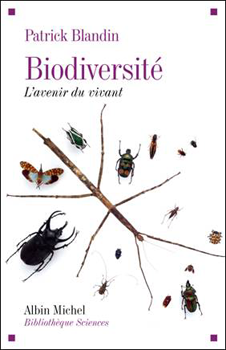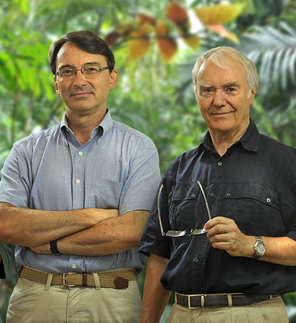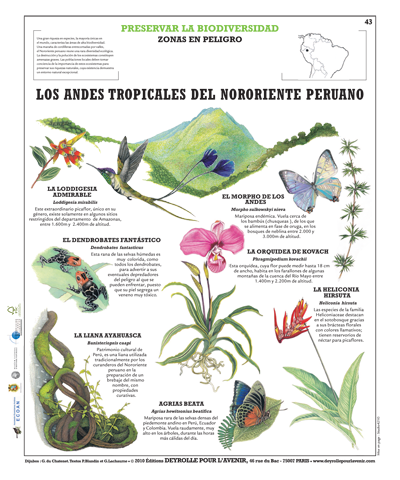Portfolio Categories : Les Carnets de Patrick Blandin
Petite histoire de la découverte des morphos dans le nord-est du Pérou
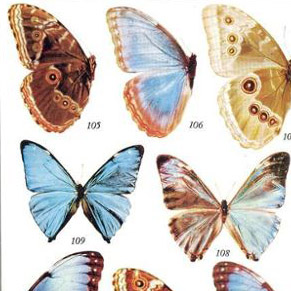
[dropcap]L[/dropcap]a connaissance des morphos du Pérou a commencé il y a près de 140 ans. A la fin du 19e siècle, et jusque vers la fin des années 1930, les découvertes furent le fait de collecteurs surtout européens, voyageant où même s’installant définitivement au Pérou. Certains ont travaillé pour des entomologistes privés, qui avaient organisé des firmes consacrées au commerce des insectes.
C’est dans les années 1870 et 1880 que parurent les premières descriptions d’espèces péruviennes : M. lympharis Butler, 1873 ; M. zephyritis Butler, 1873 ; M. alexandrovna Druce, 1874 ; M. didius Hopffer, 1874; M. papirius Hopffer, 1874 ; M.rhetenor var. cacica Staudinger, 1876 ; M. iphiclus var. amphitryon Staudinger, 1887 ; M. deidamia var. pyrrhus Staudinger, 1887. Tous ces taxons avaient été découverts dans des localités du sud et du centre du Pérou, les cinq derniers dans la vallée de Chanchamayo (département du Junín).
La vallée du río Huallaga, plus au nord, commença à être prospectée dans les années 1880, mais, jusqu’à la fin des années 1930, seule la moyenne vallée avait fait l’objet de collectes, dans les régions de Juanjuí et de Tarapoto (département San Martín). Lorsque les français Eugène Le Moult et Pierre Réal, de 1959 à 1961, préparaient l’ouvrage Les Morpho d’Amérique du Sud et Centrale, paru en deux parties, en 1962 et 1963, ils n’eurent connaissance que de spécimens collectés avant la Deuxième Guerre Mondiale. A partir des années 1960, ce fut la haute vallée, dans la région de Tingo María (département Huánuco), qui connut une longue phase de collecte intense, tandis que la moyenne vallée n’était plus prospectée, pour une part en raison du terrorisme, dont Tarapoto fut un centre. Depuis 2005, avec Gilbert Lachaume, j’y ai engagé un programme de recherche qui concerne aussi plusieurs vallées affluentes. Cependant, en raison du développement de cultures illicites, il est toujours déconseillé de circuler entre Tingo María et Juanjuí.
1. Les acteurs historiques
Les « savants-commerçants »
L’une des plus fameuses firmes entomologiques fut fondée par Otto Staudinger (1830-1900), titulaire d’un doctorat de l’université de Berlin (1854). Pour payer ses voyages entomologiques, il avait commencé un commerce d’insectes. Il s’installa en 1859 à Dresde et développa son entreprise ; à partir des années 1880, elle devint la firme Staudinger et Bang-Haas, du nom du gendre de Staudinger, Andreas Bang-Haas (1846-1925). Celui-ci poursuivit l’activité après le décès de son beau-père, et son fils, Otto Bang-Haas (1882-1948) prit le relais en 1913. L’entreprise s’arrêta en 1948. En Allemagne également, Hans Fruhstorfer (1866-1922), tenait un commerce d’insectes à Munich, et Friedrich Wilhem Niepelt (1862-1936) en faisait autant à Zirlau.
Otto Staudinger, Hans Fruhstorfer et Friedrich Niepelt n’étaient pas que des commerçants. Entomologistes, ils firent un véritable travail scientifique. C’est ainsi que Staudinger décrivit en 1890 le premier morpho du bassin du Huallaga, la variété helena de Morpho rhetenor, un splendide papillon devenu pour les collectionneurs l’emblème de la région. Fruhstorfer fut l’auteur de la première révision de l’ensemble du genre Morpho, publiée en 1912 et 1913 dans le volume 5 de l’ouvrage monumental Die Gross-Schmetterlinge der Erde, dirigé par Aldabert Seitz (1860-1938). Il y décrivit deux variétés du genre Morpho provenant du bassin du Huallaga. Niepelt fut l’auteur de quelques descriptions de Morpho, une seule concernant cette région.
En France, à Paris, Eugène Le Moult (1882-1967) créa en 1909 un « cabinet entomologique », qui devint le plus important commerce d’insectes au monde. Passionné depuis l’enfance par les papillons, il avait fait un premier séjour, entre 15 et 17 ans, en Guyane française, où son père était chef du service des travaux pénitentiaires. Il y retourna en 1903, puis en 1907. Eugène Le Moult anima jusqu’à la fin de sa vie son cabinet, et en fit une maison d’édition, qui réalisa en particulier la version française de Die Gross-Schmetterlinge der Erde. Fasciné, entre autres papillons, par les morphos, il publia en 1962, avec l’aide de l’entomologiste Pierre Réal (1922-2009), la première grande synthèse sur le genre Morpho, illustrée en 1963 par un volume de planches. On y trouve la description de quelques spécimens de la vallée du Huallaga.
Les chasseurs pionniers
Le collecteur allemand Gustav Garlepp (1862-1907), parcourut différentes régions du Pérou entre 1884 et 1887 pour le compte de la firme Staudinger & Bang-Haas. Il fut vraisemblablement le premier à prospecter dans la région de Juanjuí, où il captura les premiers mâles de M. rhetenor helena. Un autre chasseur allemand, Otto Michael (1859-1934), qui travailla pour la même firme, vint en 1891-1892 à Iquitos, puis y vécut de 1894 à 1921. Il effectua des collectes notamment dans la vallée du Huallaga, en particulier aux environs de Tarapoto et de Juanjuí. En 1924, un troisième allemand, Guillermo Klug (1875- ?), arriva au Pérou et s’installa à Iquitos. Collecteur de plantes, il chassa en outre les papillons et en envoya notamment au Cabinet entomologique d’Eugène Le Moult. Il a collecté dans les régions de Moyobamba et de Jepelacio (dans la vallée du río Mayo, un affluent du Huallaga), de Tarapoto et de Chazuta, et dans celle de Juanjuí.
Par l’intermédiaire des firmes, ou directement, les spécimens capturés par ces chasseurs parvinrent soit dans les collections des muséums, soit chez des collectionneurs privés, comme Lord Lionel Walter Rothschild en Angleterre, Robert Biedermann en Suisse, Aimée Fournier de Horrack, George Rousseau-Decelle et Robert Stoffel en France. Klug fut vraisemblablement le dernier à envoyer en Europe des spécimens de la moyenne vallée du Huallaga.
En 1924-1925, une expédition suédoise avait fait quelques collectes dans la région de Roque, une localité du bassin du río Sisa. Il s’agit d’un affluent de la rive gauche du Huallaga, qui y débouche en aval de Juanjui. C’est seulement en 1953 que Felix Bryk (1882-1957) publia l’inventaire des espèces récoltées, et décrivit deux variétés de morphos.
2. 1961-1998 : la haute vallée du Huallaga s’ouvre, la vallée du Huayabamba s’entrouvre
Du haut Huallaga (la région de Tingo María), rien n’était connu lorsque Eugène Le Moult entreprit d’écrire son ouvrage sur le genre Morpho. Il s’appuyait sur sa riche collection, mais aussi sur de nombreuses collections européennes, que son collaborateur, Pierre Réal, visita de 1959 à 1961. Ils avaient arrêté leur recherche documentaire en septembre 1961, sans avoir connaissance d’une publication parue en 1960, dans laquelle Pierre Viette, le responsable des collections de Lépidoptères du Muséum de Paris, validait des noms donnés, mais non publiés (noms dits « in litteris »), par Otto Michael à quelques spécimens de Juanjuí conservés dans la collection Fournier de Horrack. Peu après la parution de leur livre, imprimé en mai 1962, un collectionneur allemand, Edmund Weber, décrivait en septembre le taxon M. leonte fischeri d’après un mâle de Juanjuí et deux mâles de Tingo María. En février 1963, cet auteur décrivait à nouveau des morphos de Tingo María, malheureusement sans indiquer qui les avait capturés, et dans l’ignorance de l’oeuvre de Le Moult et Réal.
Au cours des années 1960, une française mariée à un américain travaillant à Lima, Gisèle Harris, a collecté dans la région de Tingo María. Elle m’envoya des morphos, en particulier une femelle de M. helena, capturée en décembre 1965. Ce fut sûrement l’une des premières, sinon la première, capturées dans cette région. J’ai décrit ce spécimen en 1968, comme forme individuelle, sous le nom Morpho helena f. ind. harrisia. Elle possédait aussi des spécimens fournis par un Péruvien originaire du Cajamarca, Mario Digno Rojas Villegas. Celui-ci s’était installé à Tingo María en 1963, et avait commencé un travail de collecte et de commercialisation de papillons de la région. Cette activité permit, pendant près de 30 ans, la diffusion de très nombreux spécimens dans beaucoup de collections, notamment par l’intermédiaire de revendeurs européens. De nouvelles variétés de morphos furent ainsi découvertes : M. amphitryon cinereus Duchêne, 1985 et M. amphitryon duponti Duchêne, 1989, décrits par Gérard Duchêne, un collectionneur de Lille, et M. cisseis gahua Blandin, 1988, décrite dans The Genus Morpho (part 1).
Au tout début des années 1970, un collectionneur français, Georges Jeannot, apprit par Jean-Luc Verley, un autre collectionneur qui parcourait la Colombie et le Pérou, l’existence d’un collecteur de papillons dans le département Amazonas, à Mendoza. Ce collecteur aurait eu pour nom « Rodriguez ». Georges Jeannot suggéra à Gilbert Lachaume de lui écrire, ce dernier commençant à s’intéresser aux insectes d’Amérique tropicale. La lettre, adressée au « Señor Rodriguez, cazador de mariposas, Mendoza, Peru », attendit un an à la poste de Mendoza, car « Rodriguez de Mendoza », c’est le nom de la province ! Mais un postier la remit effectivement à un chasseur, Benigno Calderón, qui répondit. Il avait été formé par un collectionneur autrichien, Franz König, qui a longtemps séjourné au Pérou et avait prospecté dans le département Amazonas. Une relation suivie s’établit avec Gilbert Lachaume. Benigno Calderón collectait principalement près de Mendoza, vers 1800 m d’altitude. Mendoza se trouve dans la vallée du río San António, qui devient en aval le río Huambo puis le río Huayabamba… là où avait chassé Gustav Garlepp, un siècle plus tôt. Une année, Benigno envoya deux mâles de M. sulkowskyi, un peu curieux. J’en fis état en 1993, dans The Genus Morpho (part 2), ainsi que d’une femelle, dont Franz König m’avait envoyé une photo. J’estimai alors ne pas pouvoir nommer ces trop peu nombreux spécimens, en dépit de caractères particuliers. Parfois, Benigno collectait plus bas, jusque vers 1200-1000 m d’altitude, dans le bassin du río Huambo. Il se rendait aussi à Juanjui, où il avait de la famille. C’est ainsi qu’il envoya à Gilbert Lachaume quelques M. rhetenor helena, mâles et femelles, datés des années 1990.
3. 1998- 2011 : une nouvelle dynamique
En 1998, Gilbert Lachaume et un ami, Bruno Allain, firent un voyage dans la région, pour rencontrer Benigno Calderón à Mendoza puis, de là, rejoindre Tarapoto. Avec Benigno, ils empruntèrent en voiture la « via marginal », à l’époque en cours d’aménagement. Le 27 avril 1998, le long de l’Abra Pardo Miguel, col permettant de passer de l’Amazonas à l’Alto Mayo, dans le San Martín, Bruno Allain captura un mâle de M. sulkowskyi assez particulier.
Gilbert Lachaume conseilla à Benigno Calderón de chasser plus en altitude dans sa vallée, ce qui permit d’obtenir de nouveaux spécimens du M. sulkowskyi signalé en 1993. Il l’incita aussi à aller vers l’Alto Mayo, grâce à la « via marginal ». Cette région était en effet pratiquement inconnue du point de vue entomologique, si ce n’est que le Dr. Gerardo Lamas, chef du département d’entomologie du Muséum de Lima, y était passé des années auparavant, et avait capturé le même M. sulkowskyi que Bruno Allain.
La via marginal traverse l’Alto Mayo, région montagneuse couverte de belles forêts protégées par une décision gouvernementale en date de 1987 (statut de « bosque de protección »). Dès 1979, la construction de cette voie favorisa l’immigration de populations pauvres, originaires en majorité du département de Cajamarca. Ces gens s’installaient dans l’Alto Mayo et commençaient à défricher, ce qui motiva la décision de créer une zone de protection. La transformation de la voie en une véritable route asphaltée, qui était en cours en 1998, accéléra encore ce phénomène. Des villages riverains furent créés (Jorge Chavez, El Affluente), et d’autres furent peu à peu établis plus à l’intérieur de la zone protégée, avec souvent des noms témoignant des attentes des migrants (Nuevo Edén, La Esperanza, El Triumfo, La Libertad, El Paraiso del alto Mayo, Nueva Jordania…). Benigno Calderón, évangéliste prosélyte, visita certains villages ; il y initia une activité de collecte de papillons, qui prit vite de l’ampleur. Rapidement, des spécimens apparurent dans les circuits commerciaux internationaux, grâce à des revendeurs bénéficiant de permis d’exportation. C’est ainsi que me sont parvenus des spécimens de cette région, et que j’ai décrit, notamment avec le Dr. Gerardo Lamas, des sous-espèces nouvelles (Blandin, 2006 ; Blandin & Lamas, 2007), dont les holotypes sont déposés au Muséum de Lima. Les informations réunies ont permis la publication d’une liste des morphos de l’Alto Mayo dans le plan de gestion officiel du bosque de protección, liste qui souligne la richesse et l’originalité de cette région (Blandin, 2008).
C’est parce que Gilbert Lachaume avait « découvert » la région de Mendoza et traversé l’Alto Mayo, que nous décidâmes tous les deux d’engager un programme de recherche sur la distribution des Lépidoptères dans les départements d’Amazonas et du San Martín. Nous avons démarré ce programme en 2005. Initialement soutenu financièrement par le Muséum National d’Histoire Naturelle, et mené en collaboration avec le Dr. Gerardo Lamas, il se poursuit actuellement, au nom du Muséum mais avec nos propres moyens, à raison d’un ou deux voyages par an. Au départ de notre projet, bien des questions se posaient sur la répartition des espèces et des sous-espèces, en particulier sur les modalités de la transition entre la faune du bassin amazonien occidental, assez bien connue dans la région d’Iquitos, surtout grâce à Michael et Klug, et celle de la haute vallée du Huallaga, connue grâce au commerce de Mario Rojas. Comparativement, les données sur les régions s’étendant de Tarapoto à Juanjuí se montraient très insuffisantes, en dépit des collectes historiques. Depuis 2007, avec l’autorisation de l’administration péruvienne compétente, nous avons développé une prospection systématique dans un ensemble de localités formant une couverture géographique inégalée du bassin moyen du Huallaga, tout spécialement de la région de Juanjuí à celle de Tarapoto. Bien des questions ont trouvé des réponses, mais les surprises n’ont pas manqué… Les recherches sur le terrain continuent, mais des publications sont d’ores et déjà en préparation.
La biodiversité et le développement durable

1. L’irruption et le succès d’un néologisme
[dropcap]D[/dropcap]epuis toujours, les humains ont cherché à appréhender la diversité des espèces vivant près d’eux. Au 18e siècle, la démarche scientifique de l’histoire naturelle a structuré l’inventaire, la nomenclature et la caractérisation des espèces. Les naturalistes Linné et Buffon, pour ne citer que les plus grands, étaient des spécialistes de la diversité du monde vivant ! Dès le 19e siècle, avec la géographie botanique, et plus encore au 20e siècle, avec le développement de l’écologie, les scientifiques ont cherché à comprendre pourquoi la richesse en espèces différentes varie d’une région à une autre, pourquoi tel écosystème permet la coexistence d’un plus grand nombre d’espèces que tel autre. A partir des années 1950, la question de la « diversité spécifique » des écosystèmes a suscité quantité de recherches, jusqu’au début des années 1980. C’est ainsi qu’au laboratoire de Zoologie de l’ENS, où je préparais ma thèse sur le peuplement d’araignées de la savane de Lamto, nous étions plusieurs chercheurs travaillant sur la diversité spécifique, notamment d’un point de vue théorique, en particulier pour tenter d’interpréter les différences de diversité en termes de plus ou moins grande adaptabilité des écosystèmes, dans le cadre du concept de « stratégie adaptative », alors à la mode (Publications 28, 53, 61, 80, 85). On ne parlait pas encore de « biodiversité »…
C’est en 1985 que le terme « BioDiversity », contraction de « Biological Diversity », a été inventé, comme titre d’un Forum tenu à Washington en 1986. Il a été mondialement diffusé en 1988 avec la publication du livre issu de ce Forum, BioDiversity (Wilson & Peter, editors). A la suite du Sommet de Rio de Janeiro où fut signée la convention sur la diversité biologique, des scientifiques français ont commencé à publier des ouvrages sur le sujet.
Le premier ouvrage français, « La biodiversité, enjeu planétaire » (éditions Sang de la terre), paru début 1993, est dû à Michel Chauvet, du Bureau des Ressources Génétiques, et Louis Olivier, conservateur du Conservatoire Botanique national de Porquerolles. En 1994, Robert Barbault, Professeur à l’Université Paris VI, publie chez Odile Jacob « Des baleines, des bactéries et des hommes », et Christian Lévêque, Directeur de recherche à l’ORSTOM, écrit « Environnement et diversité du vivant » dans la collection Explora de la Cité des Sciences et de l’Industrie. La diversité biologique est au coeur de l’ouvrage « Biogéographie. Approche écologique et évolutive » de Jacques Blondel, Directeur de recherche au CNRS, paru chez Masson en 1995. Le regard critique que Jacques Blondel porte sur le mot « biodiversité » mérite toujours d’être médité. Au début du chapitre intitulé « La diversité biologique en péril », Jacques Blondel pose la question « Qu’est-ce que la biodiversité ? », et y répond ainsi :
Dans ce contexte d’une gravité sans précédent dans notre histoire, le terme de « biodiversité », introduit pas Wilson et Peter (1988) a envahi la littérature scientifique et s’est infiltré dans le jargon médiatique et administratif, notamment depuis la Conférence des Nations unies sur l’Environnement et le Développement (Rio de Janeiro, juin 1992). Les citations, dans la littérature scientifique, d’expressions telles que « biodiversité » ou « diversité biologique » sont passées d’une dizaine de fois en 1984 à plus de 300 fois en 1992 (Haila et Kouki, 1994). La « biodiversité » est même considérée comme une ressource naturelle, source de nouvelles activités économiques (élevage, génie génétique, industrie pharmaceutique, génie de l’environnement). Des revues générales sur la biodiversité se multiplient (cf. par exemple Lubchenko et al., 1991 ; Solbrig, 1991 ; Groombridge, 1992 ; Solbrig et al., 1992 ; ICBP, 1992 ; Schulze et Mooney, 1993 ; Barbault, 1994), etc.
Mais la « biodiversité » n’est pas un concept, encore moins un paradigme ; c’est une coquille vide où chacun met ce qu’il veut, un « mot de passe » pour paraphraser ce qu’écrivait Lecourt (1993) à propos de l’environnement. Le mot est ambigu parce qu’il est à la fois purement descriptif et chargé de complexité (la diversité signifie la pluralité mais aussi les relations entre éléments constitutifs de cette pluralité). Définir la biogéographie évolutive comme l’étude spatio-temporelle des diversités biologiques, de leur origine, de leur évolution et de leur régulation dans des espaces hétérogènes et changeants, comme on l’a fait au début de ce livre, c’est « faire de la biodiversité » comme le font, depuis des décennies, tous les ouvrages qui traitent d’écologie et d’évolution. Il convient donc de faire une distinction entre le sens qu’on donne au mot, à savoir la nature des phénomènes biologiques qu’il prétend désigner, et son utilisation en tant qu’argument en faveur de l’urgence de mesures à prendre pour conserver cette biodiversité (Haila et Kouki, 1994). La popularité actuelle du terme comporte des dangers de confusion parce qu’il est utilisé dans des sens différents et ne se réfère à aucun phénomène nettement défini. Il ne s’agit pas seulement d’une question sémantique, car le mot peut légitimement s’appliquer à une vaste gamme de domaines touchant à l’écologie, l’économie, la biologie de la conservation, les sciences sociales, l’éthique de l’environnement, etc. Tout ce qui est « bio » et divers, les systèmes biologiques naturels, les cultures humaines, la « sociodiversité », les services attendus de l’environnement, les ressources génétiques, etc. relève de la biodiversité. Bien des tentatives ont été faites pour mettre un peu d’ordre dans cette multitude de choses et d’idées. Pour rester dans le domaine des systèmes naturels étudiés dans ce livre, on peut dire d’une manière très générale que la diversité biologique est la quantité et la structure de l’information contenue dans des systèmes vivants hiérarchiquement emboîtés.
Jacques Blondel, 1995. Biogéographie. Approche écologique et évolutive pp. 225-226)
Le terme de biodiversité s’est cependant imposé, dans le monde scientifique comme dans le monde politique. En témoigne le Millenium Ecosystem Assesment, travail d’évaluation de l’état des écosystèmes de la planète commandé par le Secrétaire Général de l’ONU, et publié en 2005 (www.maweb.org/documents/document.354.aspx.pdf ). Un autre événement marquant fut la Conférence internationale « Biodiversité : science et gouvernance », voulue par le Président Jacques Chirac, qui s’est tenue à Paris en janvier 2005. Ce fut l’occasion, pour les scientifiques, d’appeler à la création d’une structure internationale d’expertise sur la biodiversité et les « services écosystémiques ».
Des membres de l’Académie des Sciences, à l’occasion de l’année 2010, ont exprimé, chacun à sa manière, leurs points de vue sur la biodiversité (Biodiversité : points de vue d’académiciens).
Dans un livre que j’ai publié en 2009, j’ai analysé comment la « biodiversité » s’est substituée à la « nature » (Publication 211) et, dans un ouvrage collectif à paraître en hommage à la philosophe Catherine Larrère, qui a fortement contribué au développement de l’éthique environnementale en France, j’ai écrit un chapitre où j’explore la question de savoir si la biodiversité n’est pas en réalité un « substitut technocratique » de la nature.
2. Promouvoir la connaissance et la conservation de la biodiversité
En 1989, lors du travail de préparation de la Grande Galerie de l’Evolution (GGE), le concept de biodiversité fut pris en compte grâce à Jean Servan, membre du commissariat scientifique de la partie consacrée aux relations Homme-Nature et intitulée « L’homme, facteur d’évolution ». Dans une conférence au Conseil Général du Génie Rural, des Eaux et des Forêts, en 1991, j’expliquai que la GGE était pensée « pour que le visiteur comprenne cette idée majeure : la biodiversité, produit de l’évolution, est déjà, et désormais sera totalement le produit de la co-évolution homme-nature » (Publication 112). Dans le petit livre collectif présentant les thèmes de la Galerie, nous avons souligné l’importance de la dimension éthique du problème du devenir de la biodiversité (Publication 136 ; télécharger un extrait de L’Évolution).
En 1989, à la demande des Editions Bordas, j’ai commencé à préparer un livre collectif sur la nature en Europe, qui est paru d’abord chez France Loisirs en août 1991, puis chez Bordas en 1992. L’accent était mis sur la diversité, avec un emploi encore timide du mot « biodiversité » (Publication 117, 117bis).
J’ai donné ma première conférence sur la biodiversité, à l’invitation de la Société des Amis du Muséum, le 10 mars 1990. Elle était intitulée « Écologie et gestion de la biodiversité : perspectives actuelles ». Inspirée notamment par le travail en cours sur les relations Homme-Nature pour la Grande Galerie de l’Évolution, elle se terminait en soulignant que ces relations devaient être abordées plus sous l’angle éthique qu’économique, que l’homme était culturellement divers, et que le droit à la différence et le respect des différences créait un lien entre droit de l’homme et droit de la nature.
Après le Sommet de Rio de Janeiro, en 1992, les scientifiques ont commencé à être sollicités pour expliquer la problématique de la biodiversité à des publics variés.
En mars 1994, par exemple, j’ai donné une conférence intitulée « Conservation de la biodiversité, écologie, éthique » aux Rencontres littéraires et artistiques de Sceaux. En janvier 1995, j’ai été invité aux Rencontres Natura 2000 de la Région Centre pour donner une conférence intitulée « La biodiversité : concept et enjeux ». C’était l’époque où la mise en oeuvre du programme européen Natura 2000, visant à la protection d’un ensemble d’habitats naturels et d’espèces en danger soulevait bien des interrogations et provoquait des polémiques dans le monde rural, au point que le gel de ce programme fut décidé par le gouvernement en 1995. La même année, le Ministère de l’environnement fêtait son 25e anniversaire et publiait à cette occasion un petit ouvrage auquel j’ai participé… pour parler de biodiversité et de disparition des espèces (Publication 135).
Dans la perspective de l’année 2000, je me suis engagé dans la préparation d’une exposition temporaire qui serait consacrée, au travers de la présentation de spécimens exceptionnels des collections du Muséum, à la sensibilisation et à la conservation de la diversité de la nature. En lien avec ce projet, j’ai dirigé l’ouvrage « Trésors de Nature » (octobre 1999), anthologie de textes sur la diversité de nos rapports à la nature associée à des photographies de spécimens aussi divers que possible ; dans un épilogue intitulés « Futurs », j’invitais à réfléchir à la conservation de la diversité (Publication 157 ; télécharger un extrait de Trésors de Nature).
Le Sommet de Johannesburg (2002), à l’occasion duquel la communauté internationale s’était engagée à réduire significativement la perte de biodiversité à l’horizon de l’an 2010 fut suivi par la multiplication des sollicitations.
J’ai par exemple été sollicité dans les milieux catholiques. En 2002, le texte d’une conférence « La biodiversité : questions scientifique, problème de société » a été publié dans la revue Réflexions chrétiennes (Publication 169). Au cours des années 2003-2004, J’ai travaillé avec l’antenne « Environnement et modes de vie » de Pax Christi France à l’ouvrage « Planète Vie, Planète Mort, l’heure des choix » (Marc Stenger dir., 2005), où j’ai rédigé le chapitre « La biodiversité, héritage pour le futur » (Publication 191). Récemment encore, j’ai évoqué « La foisonnante créativité de la vie » dans le cadre d’un dossier sur le thème « Création, créativité » publié par Nouvelles rive gauche, le mensuel chrétien des 5e et 6e arrondissements de Paris (Publication 242).
En 2004, j’ai été invité à l’Institut d’études et de recherches africaines de l’Université du Caire, par le Professeur Samir Ghabbour, pour des « lectures » sur la biodiversité (Publications 177, 178, 179). C’est dans un ouvrage conçu en hommage au Professeur Ghabbour que j’ai publié en 2004 un premier article abordant la problématique de la conservation de la biodiversité à la fois sous un angle évolutionniste et sous un angle éthique (Publication 180). A la demande de la revue professionnelle Forêt-entreprise, j’ai participé à un dossier sur la biodiversité (Publication 183). Je suis intervenu aussi bien dans une formation de religieux Franciscains qu’aux Entretiens du Génie Rural, des Eaux et des Forêts, qui étaient consacrés au thème « Biodiversité : quels enjeux et quelles perspectives ? », ou encore dans une formation « Infrastructures et nature » organisées par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable ave une présentation intitulée : « Biodiversité et fonctionnement des écosystèmes ». J’ai également été invité à la Réunion pour la Fête de la Science ; entre autres activités, j’y ai donné une conférence à l’Université, intitulée « La biodiversité, de la systématique à l’écologie ».
Parallèlement, impliqué au nom du Muséum dans la préparation de la conférence mondiale « Biodiversité : Science et Gouvernance » (Paris, 24-28 janvier 2005), j’ai contribué avec Bernard Chevassus-au-Louis et Robert Barbault à l’ouvrage publié à cette occasion (télécharger la Publication 186). L’essentiel de notre texte a été repris dans l’ouvrage « Pour la biodiversité », manifeste publié par la Ligue Roc (Publication 192).
En 2006, j’ai présenté une conférence « Biodiversité et adaptabilité durable » à des publics d’enseignants, à Grenoble lors d’une journée organisée par le Muséum de Grenoble et le Rectorat, puis au Muséum de Paris pour une formation d’enseignants de l’Académie de Créteil. Depuis, je suis intervenu à différentes reprises dans des sessions de formation organisées par le Muséum.
A la suite d’une conférence-débat à l’INRA, dans le cycle « Sciences en questions », en octobre 2007, j’ai publié en 2009 un ouvrage analysant, en particulier sous l’angle historique, le passage de ce que l’on appelait la « protection de la nature » à ce que l’on désigne aujourd’hui par « gestion de la biodiversité », qui peut aller jusqu’à un véritable pilotage (Publication 211).
A la demande des éditions Albin Michel, je préparais parallèlement un ouvrage grand public sur la biodiversité, que j’ai vraiment commencé à écrire au Pérou, en novembre 2008, en vue d’une publication au début de l’année 2010, « Biodiversité, l’avenir du vivant » a été couronné par quatre prix, dont l’un des Grands Prix 2010 de l’Académie française (Prix littéraires). La parution de ce livre a entraîné de multiples interventions, à Paris et en régions, sous forme de conférences, tables-rondes, cafés de science…, ainsi que des articles de vulgarisation. Par exemple, dans le cadre d’un ouvrage publié par l’association « la Demeure historique », intitulé « Les Monuments Historiques Acteurs du développement durable », j’ai été interviewé sur la préservation de la biodiversité ; j’ai souligné le fait que ces propriétés, auxquelles sont souvent associés des jardins et des parcs, peuvent aussi contribuer à la conservation de la biodiversité (Télécharger l’article). En 2012, j’ai été invité au 6e Festival Philosophia, à Saint-Emilion, consacré à « La Nature ». J’y ai donné une conférence sur le thème « La biodiversité : une notion récente, un enjeu éthique majeur ».
3. Biodiversité et politique scientifique du Muséum National d’Histoire Naturelle
Le succès de l’idée de biodiversité, qui pouvait faire espérer une relance des « sciences naturelles traditionnelles », trop longtemps délaissées dans les universités, justifiait que les muséums s’approprient le « nouveau » concept. Nommé au Muséum en septembre 1988, je me suis retrouvé impliqué dès 1989 dans la thématique de la biodiversité. A la demande du Directeur du Muséum (Philippe Taquet), j’avais été chargé, avec notre collègue Jean-Claude Lefeuvre, d’une mission de réflexion en vue de constituer un comité consultatif d’experts en matière de protection de la nature. Dans ce contexte, à la suite de discussions à l’Assemblée des Professeurs, j’ai élaboré un document de travail sur les actions possibles de l’établissement vis-à-vis des problèmes d’environnement et de gestion de la biodiversité. Je proposais de structurer la recherche selon deux grands axes : 1) Le présent et l’histoire de la biodiversité ; 2) Fondements et pratiques de la gestion de la biodiversité. Enfin, des propositions précises étaient faites pour la création et le fonctionnement d’un « Comité consultatif du Muséum National d’Histoire Naturelle pour la gestion du patrimoine naturel », destiné à répondre aux demandes d’expertise émanant de l’Etat et de divers partenaires.
Progressivement, la biodiversité s’est imposée dans la politique scientifique du Muséum et dans l’organisation de ses structures de recherche. Parallèlement, l’idée de créer une structure dédiée à l’expertise faisait son chemin.
Le 29 mars 1990, les directeurs des laboratoires d’Ecologie Générale (Patrick Blandin), d’Evolution des Systèmes Naturels et Modifiés (Jean-Claude Lefeuvre), d’Ethnobiologie-Biogéographie (Yves Monnier), d’Ethologie et de Conservation des Espèces Animales (Jean-Jacques Petter), et le directeur du Secrétariat de la Faune et de la Flore (Hervé Maurin) proposaient la création d’un Département intitulé « Ecologie, Relations Homme-Nature et Conservation de la Biodiversité », qui aurait eu en charge, entre autres missions, l’animation de la cellule chargée de la coordination de l’expertise ; un organigramme fut établi le 4 avril. Un document préparatoire, daté aussi du 29 mars, proposait pour titre « Ecologie, Ethnobiologie, Environnement » : l’introduction de la « biodiversité » dans le titre définitif montre que d’ultimes discussions nous conduisirent à utiliser ce néologisme prometteur. Le 5 avril, Jean-Claude Lefeuvre précisait dans une note à l’intention du Conseil Scientifique le projet de Cellule Nature-Environnement.
Lors d’un Conseil Scientifique consacré à l’éventuelle mise en place de départements, l’idée fut avancée de placer le laboratoire d’Ethnobiologie-Biogéographie dans un département « Sciences de l’Homme », ce qui provoqua une vive réaction de ce laboratoire, désireux de s’intégrer dans le Département « Ecologie, Relations Homme-Nature et Conservation de la Biodiversité ». L’affaire en resta là, la décision de créer des départements ne se concrétisant pas.
En 1991, chargé de mission pour les collections auprès du nouveau Directeur du Muséum (Jacques Fabriès), j’ai élaboré un document de politique générale sur la recherche en systématique et la valorisation des collections, soulignant le rôle du Muséum comme « analyste de la diversité » (télécharger le document 1991 P. Blandin Politique Collections Muséum ) :
« Alors que d’autres établissements ont plus spécialement mission d’étudier les composantes et les lois fondamentales de la matière, ou d’analyser ce qui fait l’unité profonde du monde vivant, le Muséum doit au contraire porter l’effort sur l’étude de la diversité des matériaux terrestres et des êtres vivants, y compris celle des humains et de leurs cultures. Analyste de la diversité, le Muséum doit aussi contribuer à en expliquer la genèse.
Ceci suppose une démarche de recherche qui s’initie dans les procédures d’inventaire pour se développer dans l’analyse des processus et des événements transformateurs, diversificateurs ou réducteurs des composantes de l’écosphère. »
Fin 1991, le Directeur du Muséum diffusait une déclaration de politique scientifique comprenant notamment une rubrique « Biodiversité et Systématique », et affirmant qu’il est de la responsabilité scientifique du Muséum de contribuer à une « véritable Écologie de la Biodiversité ».
Au début de 1992, j’ai contribué avec Jean-Claude Lefeuvre à l’institution d’un Comité Muséum-Environnement, chargé de fournir des avis sur la coordination des actions du MNHN « dans les domaines de l’environnement et de la biodiversité » et de valoriser la capacité d’expertise du MNHN dans ces domaines. La décision fut prise par arrêté du Directeur en date du 21 mai 1992. En même temps été créée une Délégation Permanente à l’Environnement, ayant une mission d’appui auprès du Directeur. Le même jour, le Directeur adressait à l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques une note sur la « Recherche en biodiversité au Muséum National d’Histoire Naturelle ». Il y écrivait :
« Analyste de la diversité, le Muséum doit aussi contribuer à en expliquer la genèse et pour ce faire, porter son effort sur l’étude de la diversité des matériaux terrestres et des êtres vivants, y compris celle des humains et de leurs cultures. »
Cette politique d’organisation interne a notamment facilité la mise en oeuvre des relations avec le Ministère chargé de l’environnement, chargé à partir de 1992 d’une co-tutelle du Muséum. Dans ce contexte, le Directeur du Muséum me nomma en septembre 1992 chargé de mission auprès de lui dans le domaine de l’environnement et de la conservation du patrimoine naturel.
Un document daté de septembre 1992 montre comment l’établissement définissait alors ses actions en matière d’environnement et sa recherche en biodiversité . En décembre 1992, un document de programmation de la recherche en environnement était établi à l’intention du Ministère de l’Environnement pour la période 1993-1996, qui mettait l’accent sur la biodiversité.
On le voit, le Directeur Jacques Fabriès, au cours des années 1991-1992, a joué un rôle majeur dans la structuration des activités du Muséum en matière d’environnement et de biodiversité. En revanche, pendant son mandat, la question de la création de départements resta en suspens.
En 1994-95, dans le cadre d’un nouveau statut du Muséum, et sous l’impulsion du nouveau Directeur, Henry de Lumley, un projet d’établissement fut élaboré pour les années 1995-1999. Pour situer l’orientation de la recherche, le document reprenait les orientations proposées dans mon document de 1991. En termes d’organisation, il prévoyait, non pas des départements, mais des instituts, pour fédérer ses compétences dans trois grands domaines, dont un « Institut d’Ecologie et Gestion de la Biodiversité » (IEGB). Reprenant notre proposition de 1990, l’IEGB fédérait le Laboratoire d’Ecologie Générale, le Laboratoire d’Evolution des Systèmes Naturels et Modifiés, le Laboratoire de Conservation des Espèces Animales (responsable des parcs zoologiques), le Laboratoire d’Ethnologie-Biogéographie et le Secrétariat de la Faune et de la Flore (bientôt rebaptisé Service du Patrimoine Naturel). La direction de l’IEGB fut confiée à Jean-Claude Lefeuvre, et je fus nommé directeur-adjoint chargé de la recherche.
En janvier 1999, un document de communication interne, consacré au travail du Muséum dans le champ de la conservation de la nature, présentait l’IEGB et ses missions, ainsi que l’action du Muséum dans le cadre de l’ Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). Malheureusement, les instituts n’avaient pas d’existence statutaire. Le besoin de changer de statut et de rénover le Muséum se faisait de plus en plus ressentir.
La rénovation du Muséum avait été annoncée par le Premier Ministre Lionel Jospin le 5 novembre 1998, lors de l’allocution qu’il prononça à Fontainebleau à l’occasion du 50e anniversaire de la création de l’UICN. Des inspections générales des Finances et de l’Education nationale aboutirent en 1999 à un rapport d’ensemble sur la situation du Muséum. Un Comité scientifique d’orientation (CSO), présidé par le Professeur Guy Ourisson, Membre de l’Institut, élabora un rapport daté du 10 novembre 2000, où il écrivait :
« (…) une mission scientifique centrale, clairement identifiée, doit être assignée à l’établissement : l’inventaire raisonné de la biodiversité dans une perspective évolutionniste (…) ».
Plus loin, il recommandait :
« un investissement multiforme de l’établissement dans la question de la préservation de la biodiversité en relation avec la problématique du développement durable ».
Ailleurs, le CSO définissait ainsi la mission centrale du Muséum : « Découvrir, comprendre, révéler et aider à préserver la diversité naturelle et culturelle de la Terre ». Ce faisant, il ne faisait que redire ce que les textes de 1991, 1992 et le projet 1995-1999 avaient exprimé. Toutefois, la préservation de la diversité était davantage mise en relief et liée à la problématique du développement durable, laquelle venait sur le devant de la scène politique.
Un nouveau statut fut promulgué en 2001. En avril 2002, le Président du Muséum, Bernard Chevassus-au-Louis (qui avait été membre du CSO), présenta au Conseil d’Administration ses orientations pour les quatre années à venir (télécharger le document 2002 Orientations Président Muséum ). Il énonçait ainsi le projet global de recherche du Muséum :
« Inventorier, ordonner et comprendre la diversité biologique et écologique présente et passée, son origine, son rôle et sa dynamique, afin de contribuer à une gestion durable de cette diversité ».
Le Muséum élabora ensuite un contrat de développement 2003-2008, annoncé par le Directeur Général, Bertrand-Pierre Galey, en octobre 2003. Télécharger le document 2003 Annonce Contrat d’Etablissement Muséum
Le document officiel fut signé avec le gouvernement en juillet 2004. Dans le préambule, on peut lire :
« A l’heure où les enjeux de l’écologie et du développement durable fondés sur le respect de l’Homme et la préservation de la planète sont au coeur des préoccupations de la communauté internationale et de la politique du Gouvernement, les missions exercées par le Muséum au service de la connaissance et de la conservation de la biodiversité sont un élément majeur de la stratégie nationale de développement durable et de son rayonnement à l’étranger. »
L’implication du Muséum dans la politique nationale de développement durable s’imposait, ce qui devait le conduire à faire évoluer ses pratiques dans son fonctionnement. En 2003, le Directeur Général du Muséum nomma auprès de lui un conseiller pour le Développement Durable et l’Expertise, Vincent Graffin. Parallèlement, il m’avait chargé d’une mission scientifique portant sur la conservation de la nature, le développement durable et l’éthique environnementale. Dans le cadre de cette mission, j’ai participé en janvier 2007 à un séminaire « Développement Durable » organisé par la Direction Générale pour sensibiliser l’ensemble des responsables du Muséum, scientifiques aussi bien qu’administratifs, à la prise en compte de cette problématique dans l’ensemble des activités de l’établissement. J’y ai fait une présentation introductive, sur le thème « Le Muséum, la conservation de la nature et le développement durable ».
En 2009, le Directeur Général m’a confié une mission de réflexion et proposition sur le rôle du Muséum dans le champ de la conservation de la nature, à la suite de laquelle fut décidé la création d’une Direction du Développement Durable, de la Conservation de la Nature et de l’Expertise, aujourd’hui composante de la Direction de la Recherche, de l’Expertise et de l’Evaluation.
En application du statut de 2001, des départements de recherche avaient été créés, dont un département « Ecologie et Gestion de la Biodiversité (EGB)» et un département « Hommes-Natures-Sociétés (HNS) ». De ce fait, le département EGB n’avait pas la dimension interdisciplinaire de l’IEGB, qui associait les laboratoires d’écologie et le laboratoire d’ethnosciences. Mais des collaborations se sont tissées entre EGB et HNS, et en 2012 une nouvelle organisation se prépare : un même département devrait rassembler écologues, anthropologues et ethnologues pour étudier les interactions entre les systèmes naturels, les hommes et leurs sociétés. L’interdisciplinarité, si difficile à construire et à faire vivre, devrait connaître un nouvel élan… 22 ans après la proposition de créer un département « Ecologie, Relations Homme-Nature et Conservation de la Biodiversité ».
- Téléchargements
- 1989_Lettre_mission_Blandin
- 1989_P_Blandin_projet_biodiversite-MNHN
- 1990_Lettre_Labo_Ethnobiol_Dir_MNHN
- 1990_Projet_Cellule_Nat_Env_MNHN
- 1990_Proposition_Dept_Ecol_Ethno_Envir_MNHN
- 1991_MNHN_Politique_scientifique
- 1991_P_Blandin_Politique_collections_Museum
- 1992_MNHN_environnement
- 1995_Projet_MNHN_1995-1999
- 1999_MUSEUM_n_5
- 2002_Orientations_President_Museum
- 2007_P_Blandin_Museum_devel_durable
4. Le développement durable
En 1968, s’était tenue à Paris la « Conférence de la Biosphère », organisée par l’UNESCO avec l’appui de l’UICN. Cette conférence jeta les bases du concept de développement durable, et le programme de l’UNESCO « Man And Biosphere » (MAB) en fut l’une des applications emblématique (télécharger le document La Conférence de la Biosphère, 25 ans après). Michel Batisse, membre de l’UNESCO, qui fut la cheville ouvrière de la conférence, incita la Commission Nationale Française pour l’UNESCO à organiser un enseignement « post-universitaire », destiné prioritairement à des étudiants de pays en développement, pour les former à la prise en compte des milieux naturels dans le développement. Ce Cours Post Universitaire (CPU), intitulé « Etude et aménagement des milieux naturels », fut créé en 1969. Il s’appuyait sur trois centres : Paris, avec l’Ecole Normale Supérieure et l’Institut National Agronomique, Toulouse, avec l’Université Paul Sabatier de Toulouse, et Montpellier, avec l’Université des Sciences et Techniques du Languedoc, l’Institut de Botanique et le Centre d’Etudes Phytosociologiques et Ecologiques (CNRS). A l’Ecole Normale Supérieure, le Professeur Maxime Lamotte, l’un des fondateurs de ce cours, me demanda de le remplacer à partir de 1974, mission que j’ai poursuivie jusqu’en 2008, après avoir œuvré en 2004 pour que cet enseignement devienne une des composantes du Master du Muséum.
Au début des années 1990, le Directeur Général de l’UNESCO, Federico Mayor, avait lancé le projet de création de Chaires UNESCO. En 1993, la Commission Nationale Française pour l’UNESCO me délégua à un séminaire sur les Chaires UNESCO du Développement Durable, organisé en 1993 à Curitiba (Brésil), pour y expliquer la vision de la Commission sur les futures Chaires UNESCO. J’y ai présenté le développement durable comme un processus assurant une coévolution entre biodiversité et diversité culturelle.
En 1994, la première Chaire UNESCO centrée en France fut créée par convention entre la Commission Française et l’UNESCO, lors d’une cérémonie dans le bureau de Federico Mayor, sous le nom « Développement et Aménagement Intégré des Territoires » (DAIT). Sa direction fut confiée au Professeur Jean-Pierre Prod’homme, titulaire de la Chaire de sociologie rurale à l’Institut National Agronomique.
Ainsi impliqué dans un enseignement interdisciplinaire centré sur le développement, et en même temps dans la problématique de la conservation de la nature, j’ai progressivement travaillé sur les relations entre conservation et développement durable.
Invité à participer à une journée d’étude sur les enjeux du développement durable à Poitiers en 2004, j’ai présenté la notion d’adaptabilité durable et la nécessité d’une éthique évolutionniste (Publication 190). En 2004 également, j’ai été sollicité par l’Institut National des Sciences de l’Univers (INSU, CNRS) pour mener une réflexion sur le problème de la durabilité de l’anthroposystème, pour un colloque de prospective « Sociétés en environnements (Publication 184). La même année, j’ai été invité par l’Association des Muséums et Centres de Culture Scientifique et Technique pour donner à sa réunion annuelle une conférence sur le thème « Développement durable, sciences et patrimoine » (Publication 185).
En novembre 2007, j’ai été invité à Montréal (Insectarium, Jardin Botanique et Biodôme), notamment pour donner une conférence sur les muséums et le développement durable. En 2008, à l’occasion du Symposium International Buffon organisé par le Muséum de Paris, le Natural History Museum de Londres, les Royal Botanic Gardens de Kew et le National Museum of Natural History de Washington, j’ai donné l’une des conférences introductives, consacrée aux relations entre les institutions d’histoire naturelle et le développement durable, considérées non seulement sous l’angle historique, mais aussi en termes prospectifs (Publication 206). Dans le cadre des relations du Muséum National d’Histoire Naturelle avec les institutions muséales québécoises, j’ai publié sur ce même thème avec Vincent Graffin (Délégué du Directeur Général du Muséum au Développement Durable et à l’Expertise) dans la revue canadienne Musées (Publication 208).
En tant que l’un des responsables de la Chaire UNESCO « Développement et Aménagement Intégré des Territoires », j’ai contribué, de 2005 à 2009, à l’animation du pôle « développement durable » des Chaires UNESCO centrées en France, organisé par la Commission Nationale Française pour l’UNESCO. J’ai ainsi coordonné la réalisation d’un document sur la formation d’acteurs du développement durable, publié par la Commission (Publication 212, 212 bis). Ce fut l’occasion d’élaborer collectivement une vision du développement durable :
« Le développement est un ensemble de processus par lesquels une société humaine particulière cherche à créer les conditions les plus favorables au mieux-être matériel, intellectuel, spirituel de chacun de ses membres. Un tel développement est dit « durable » lorsque les conditions environnementales, économiques, sociales et culturelles créées par cette société à un moment donné, en fonction de ses valeurs, ne réduisent pas les moyens dont disposeront les générations qui suivent pour créer à leur tour les conditions de leur mieux-être, en fonction de leurs propres valeurs. Les sociétés humaines étant diverses, leurs projets le sont nécessairement. Mais il ne peut y avoir de développement durable que si les projets locaux sont élaborés dans un souci de solidarité planétaire, car la planète et l’humanité qui l’habite forment un unique système écologique, traçant au fil du temps une seule histoire. »
(…)
« Le développement, telle est notre conviction, ne peut donc être durable que si les capacités d’adaptation sont maintenues, voire amplifiées. L’humanité doit donc avoir pour objectif la durabilité du potentiel d’adaptation et d’évolution du vivant, aux échelles locales comme à l’échelle globale de l’écosphère. En d’autres termes, le développement n’a d’avenir que s’il assure l’adaptabilité durable de la Biosphère, en favorisant sa diversité à toutes les échelles. »
A la suite de la parution de ce document, la Commission Nationale Française pour l’UNESCO m’a délégué, ainsi qu’Arnaud Martin, responsable pour Montpellier de la Chaire DAIT, à la Conférence Mondiale sur l’Education au Développement Durable (UNESCO, Bonn, 31 mars – 2 avril 2009) pour présenter le document. J’ai ensuite été invité par l’UNESCO à la Conférence Mondiale sur l’Enseignement Supérieur (Paris, 5-8 juillet 2009), pour intervenir dans l’atelier « Développement durable et l’enseignement supérieur : Bâtir les fondations de demain ».
En 2011, j’ai été invité à participer au comité de rédaction d’une nouvelle revue, intitulée « Vraiment Durable », créée par Bettina Laville et le Comité 21. Dans le premier numéro, paru début 2012, j’ai développé ma conception des relations entre biodiversité et adaptabilité durable, en en soulignant la dimension éthique (Publication 238).
Par ailleurs, Donato Bergandi, Maître de Conférences du Muséum en Philosophie de l’Ecologie, m’a associé à la conception d’un article historique et critique sur la genèse et la signification du concept de développement durable, actuellement sous presse dans la Revue d’Histoire des Sciences (Publication 241).

Création à l’UNESCO, en 1994, de la Chaire UNESCO du Développement Durable « Développement et Aménagement Intégré des Territoires ». On reconnaît notamment au centre Michèle Delaygue, conseillère à la Commission Nationale Française pour l’UNESCO, à sa gauche le Directeur Général de l’UNESCO Federico Mayor, à sa droite Jean Sirinelli, Président de la Commission Française. Troisième à partir de la gauche du groupe, Jean-Pierre Prod’homme (Institut National Agronomique Paris-Grignon), responsable de la Chaire, et à sa droite Jean-Pierre Vincent, de l’Université Paul Sabatier (Toulouse). Deuxième à partir de la droite du groupe, Patrick Blandin (Muséum), quatrième, en arrière, Jacques Lecomte, Président du Comité MAB-France, cinquième Louis Thaler (Université de Montpellier II).
5. L’Initiative pour une Ethique de la Biosphère (UICN)
D’une idée écrite sur un coin de table à un projet international
En 2004, dans le cadre du Comité Français de l’UICN, François Moutou avait lancé une réflexion sur les aspects éthiques de la conservation de la nature. Lors d’une deuxième réunion, au Club Alpin Français (l’un des fondateurs de l’UICN, en 1948)… nous n’étions que deux ! Au cours de notre discussion, il nous vint l’idée de proposer un projet de résolution pour l’assemblée générale de l’UICN, résolution qui demanderait l’élaboration d’un « code éthique pour la conservation de la biodiversité ». Nous rédigeâmes un premier brouillon. Soutenu par le Comité Français, le projet de résolution, retravaillé, fut adopté à l’assemblée générale de Bangkok (télécharger la résolution). Le travail fut confié à l’Ethics Specialists Group de la Commission du Droit de l’Environnement de l’UICN. Pour l’essentiel, il a été pris en charge par une ONG de Chicago, le « Center for Humans and Nature » Le Muséum National d’Histoire Naturelle y a également contribué significativement. Un réseau international a été constitué. En 2008, je suis devenu l’un des quatre « Co-Chairs » du groupe de travail (avec Kathryn Kintzele, USA, Karla Matos, Brésil, et Razeena Omar, Afrique du Sud), qui s’est réuni à plusieurs reprises à Windblown Hill (Libertyville, Illinois, dans la propriété du fondateur du Center for Humans and Nature, Strachan Donnelley). Le travail a été nourri par des rencontres avec des acteurs de terrain. La première eut lieu à Windblown Hill, avec les membres de la « Chicago Wilderness ».
La seconde réunion, à laquelle je n’ai pu participer, fut organisée en Afrique du Sud par Razeena Omar, en relation avec les Parcs Nationaux sud-africains. La troisième, à laquelle j’ai participé avec Kathryn Kintzele, fut organisée par Karla Matos dans le cadre du Forum Social Mondial, à Belém (Brésil), l’objectif étant de mieux connaître l’expérience brésilienne en matière d’agendas 21. Enfin, des collègues chinois, impliqués dans la conservation de la nature dans la province du Yunnan sont venus partagés leur expérience avec le groupe de travail à Windblown Hill. www.humansandnature.org
Le projet a rapidement évolué, devenant la « Biosphere Ethics Initiative » (BEI), ou l’ « Initiative pour une Ethique de la Biosphère » (IEB), un processus dynamique, plus utile qu’un « code » figé, ayant pour objectif le développement d’une réflexion éthique au sein de tous les réseaux de l’UICN, à partir de valeurs privilégiées par le groupe de travail, de principes fondamentaux et de questionnements. L’accent est mis sur l’importance des collectivités et communautés locales, sur le débat et l’élaboration de projets fondés sur des valeurs partagées.
L’officialisation du projet
Le texte de la BEI a été finalisé en février 2010 à Paris, lors d’un atelier organisé par le Muséum National d’Histoire Naturelle avec le soutien du Ministère des Affaires Etrangères, du Comité Français de l’UICN et du Center for Humans and Nature. A la fin de l’atelier, le 18 février 2010, le texte a été présenté au Président et à la Directrice Générale de l’UICN. Le Conseil de l’UICN l’a adopté lors de sa session de juin 2010, avec des recommandations pour son développement.
A l’invitation de l’UICN, du 18 au 20 novembre 2010, Kathryn Kintzele, Karla Matos, George Rabb (membre d’honneur de l’UICN, ancien président de la Commission de sauvegarde des espèces) et Patrick Blandin ont participé à la session du Conseil au siège de l’Union (Gland, Suisse). Ils ont animé une séance de présentation de la BEI. Avec l’appui de Brendan Mackey, Conseiller pour l’Océanie, impliqué dès l’origine dans l’élaboration de l’Initiative, le Conseil a adopté une nouvelle décision pour soutenir le développement de la BEI.
Premiers développements
The Ethics of Indiana Dunes Region (septembre 2010)
Du 14 au 18 septembre 2010, Kathryn Kintzele et Karla Matos ont organisé le premier « Relato »* de mise en oeuvre de l’Initiative à l’échelle d’une petite région, sous le titre : « The Biosphere Ethics Initiative : toward a local ethic of the Indiana Dunes region ». Le Relato s’est déroulé d’abord à Windblown Hill, puis à Creekwood Inn Conservatory (Michigan City, Indiana), avec une tournée sur le terrain. De nombreuses personnes, représentant les organismes et ONG impliqués dans la conservation des dunes de la rive sud du lac Michigan ont échangés entre eux et avec des membres del a BEI, sur leurs visions, leurs valeurs, leurs démarches. A partir de là, les acteurs locaux ont élaboré « The Ethic of Indiana Dunes Region, a Call for Ethical Action ». Télécharger le PDF Ethic-of-the-Indiana-Dunes-Region_30Aug11.pdf
* Relato : nous avons décidé d’utiliser ce mot brésilien pour désigner des ateliers d’échanges et de partages de points de vue sur les démarches de conservation de la nature, en particulier à l’échelle locale.
Un autre Relato a été organisé en Jordanie, au printemps 2011, par Mayyada Abu Jaber, membre du groupe de travail de la BEI. Un compte-rendu est disponible sur www.humansandnature.org/iucn/jordan-relato-environmental
Fin 2011, un Relato a été organisé à Rio de Janeiro par Karla Matos Monteiro avec le Center for Humans and Nature, sous le titre « Toward a Local Ethic of Rio de Janeiro » www.humansandnature.org
10ème Conférence des Parties de la Convention pour la Diversité Biologique (octobre 2010)
Un « side event » a été organisé par Kathryn Kintzele à la 10ème Conférence des Parties de la Convention pour la Diversité Biologique à Nagoya (Japon), le 21 octobre 2010. Vincent Graffin, Vice-Président du Comité Français de l’UICN, Délégué du Directeur Général du Muséum National d’Histoire Naturelle pour la Conservation de la Nature et l’Expertise, y a présenté les orientations que le Muséum pourrait prendre pour mettre en oeuvre la BEI.
Lire l’article sur le site iucn.org
Conférences au Brésil (décembre 2010)
A l’invitation d’Antonio Herman Benjamin (Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Brasil, et membre de la Commission on Environnemental Law de l’UICN) et de l’Ambassade de France, j’ai participé les 6 et 7 décembre 2010 au 1° Colóquio Ambiental França-Brazil de Juízes, consacré à la protection de la biodiversité. Ce colloque, accueilli dans les locaux du Sénat, à Brasilia, était organisé par l’Ecole Nationale de la Magistrature du Brésil et par l’Association des Magistrats Brésiliens, avec le soutien de l’Instituto o Direito por um Planeta Verde, de l’Ambassade de France, de l’Association des Juges Fédéraux du Brésil, de la Commission on Environmental Law de l’UICN et du Comité Français de l’UICN. J’ai donné la conférence introductive, pour présenter les enjeux de la conservation de la biodiversité et les orientations de la BEI. Christophe Lefebvre, Conseiller de l’UICN pour l’Europe de l’Ouest et chargé des affaires internationales de l’Agence des Aires Marines Protégées (France), a présenté la réglementation française en matière de protection des espaces littoraux. Laurent Jacques, de la Cour de Cassation, Bethânia Gaschet, du Conseil d’Etat, et Sabine Saint-Germain, magistrate en fonction au Ministère de l’Ecologie, ont confronté avec des magistrats brésiliens les cadres réglementaires et les pratiques juridiques relatifs à l’environnement et à la biodiversité dans les deux pays.
Le 9 décembre 2010, un colloque analogue était organisé à Rio de Janeiro, sous la houlette de l’Escola de Magistratura Regional Federal de 2° Região.
Le 10 décembre 2010, à l’initiative de Karla Matos, et à l’invitation du Museu do Meio Ambiente do Jardim Botânico de Rio de Janeiro, j’ai donné une conférence intitulée « Muséums et conservation de la biodiversité : la dimension éthique ». Les discussions ont permis d’initier une réflexion sur la façon dont les institutions muséales pourraient s’engager dans des démarches inspirées par la BEI, en particulier dans leurs activités de recherche et de diffusion des connaissances.
La nouvelle Stratégie Nationale française pour la Biodiversité (SNB)
Au titre du Comité Français de l’UICN, j’ai participé au Comité de révision de la SNB, précisément au groupe de travail « Vision », qui a élaboré le préambule de la nouvelle stratégie, intitulé « Une vision pour agir ». La rédaction de ce texte, adopté par le Comité le 15 décembre 2010, s’est inspirée de l’Initiative pour une Ethique de la Biosphère.
La Stratégie Nationale pour la Biodiversité 2011-2020
L’Association Païolive : éthique et action
Fondée en 2004, l’Association Païolive a pour objectif la protection du bois de Païolive, dans l’Ardèche méridionale. A sa fondation, elle avait rédigée un manifeste à forte dimension éthique. Ayant pris connaissance de l’Initiative pour une Ethique de la Biosphère, elle a engagé l’élaboration d’un nouveau manifeste, qui a été adopté en assemblée générale le 28 janvier 2012.
6. La Stratégie Nationale pour la Biodiversité 2011-2020
Le 19 mai 2011, à la Cité internationale universitaire, la nouvelle « SNB » a été officiellement lancée, en présence de Nathalie Kosciusko-Morizet, Ministre chargée de l’Ecologie. A cette occasion des entreprises se sont formellement engagées à s’impliquer dans la Stratégie. Celle-ci a été préparée par un Comité de révision, présidé par Jean-Claude Ameisen. Un intense travail collaboratif a mobilisé pendant plusieurs mois de nombreux représentants d’associations, d’entreprises, de syndicats, de collectivités territoriales, d’organismes publics et de l’administration.
Au titre du Comité Français de l’UICN, j’ai participé au Comité de révision, précisément dans le groupe de travail chargé d’élaborer la « vision » de la SNB. Cela m’a permis de partager les idées de l’Initiative pour une Ethique de la Biosphère, dont l’essentiel a été intégré dans la rédaction du texte définitif.
La SNB 2011-2020 reprend à son compte les engagements de Nagoya, pris lors de la 10e Conférences des Parties pour la Diversité Biologique. Sa mise en oeuvre est maintenant effective, avec en particulier un appel à l’engagement des acteurs de la société.
La SNB précédente, lancée en 2004, avait fait l’objet, en 2010, d’une évaluation globale. Elle avait été conçue davantage de façon sectorielle, notamment avec des déclinaisons, sous forme de plans d’action, par ministères.
La SNB 2011-2020 se veut beaucoup plus participative, d’où un appel aux acteurs, collectivités, entreprises, associations, etc. Il est intéressant de constater qu’un syndicat comme la CFDT a consacré un dossier à la biodiversité et à la SNB dans sa revue, montrant en quoi les personnels, au sein des entreprises, ont un rôle à jouer dans la prise en compte des questions relatives à la biodiversité (La CFDT se préoccupe de la biodiversité).
7. Bibliographie Biodiversité et développement durable
PRINCIPAUX OUVRAGES
- 211. BLANDIN, P., 2009. – De la protection de la nature au pilotage de la biodiversité. Editions Quæ, Versailles : 122 p
- 218. BLANDIN, P., 2010. Biodiversité. L’avenir du vivant. Collection Albin Michel Sciences. Albin Michel, Paris
AUTRES PUBLICATIONS
Écologie théorique : diversité spécifique et écologie évolutive :
- 28. BLANDIN, P., BARBAULT, R. & LECORDIER, C., 1977 [1976].- Réflexions sur la notion d’écosystème : le concept de stratégie cénotique. Bull. Ecol., 7 (1) : 391-410.
- 53. BLANDIN, P., 1980.- Evolution des écosystèmes et stratégies cénotiques. In : Recherches d’écologie théorique. Les stratégies adaptatives, BARBAULT, R., BLANDIN, P., et MEYER, J.A. (éds.). Maloine, Paris : 221-235.
- 61. BLANDIN, P., 1980.- Stratégies adaptatives et organisation spatiale des écosystèmes. In : La morphogenèse, de la biologie aux mathématiques, BOULIGAND, Y. (éd.). Maloine, Paris : 169-172.
- 80. LAMOTTE, M. & BLANDIN, P., 1985.- La transformation des écosystèmes, cadre et moteur de l’évolution des espèces. In : La Vita e la sua Storia, BULLINI, L., FERRAGUTI, M., MONDELLA, F., et OLIVEIRO, A. (éds.). Scientia, Milan : 161-190.
- 85. BLANDIN, P., 1986.- L’étude de la structure spatio-temporelle des communautés d’Araignées, une contribution à l’écologie évolutive. Actas X Congr. Int. Arachnol., Jaca/Espagne, 1986, I : 143-167.
Biodiversité : le concept, les enjeux :
- 128. BLANDIN, P. & LUCE, J.-M., 1994.- La surveillance des systèmes écologiques et de la biodiversité, problèmes conceptuels et méthodologiques. Bull.Soc. ent. Fr., 99(n°spécial): 39-54.
- 134. BLANDIN, P., 1996.- La Biodiversité. Universalia 1996. Encyclopaedia Universalis, Paris: 147-154.
- 136. BLANDIN, P. (dir.), 1996.- L’évolution. Bordas, MNHN, Paris: 96 p.
- 135. BLANDIN, P., 1996.- La disparition des espèces, la biodiversité. In: GIORDAN, A., (éd.): 12 questions sur l’environnement. Ministère de l’Environnement et Z’Editions, Nice: 23-27.
- 169. BLANDIN, P., 2002.- La biodiversité : questions scientifiques, problème de société. Réflexions chrétiennes, 2002, fasc.1 : 20- 37.
- 180. BLANDIN, P., 2004.- Biodiversity, between Science and Ethics. In : SHAKIR HANNA, S.H. & MIKHAÏL, W.Z.A., (eds.) : Soil zoology for sustainable development in the 21st century. Cairo, Egypt: 3-35.
- 183. BLANDIN, P., 2004.- Pourquoi se préoccuper de la diversité biologique ? Forêt – entreprise, n° 155 – Février 2004 : 23-25.
- 186. CHEVASSUS-AU-LOUIS, B., BARBAULT, R. & BLANDIN, P., 2004.- Que décider ? Comment ? Vers une stratégie nationale de recherche sur la biodiversité pour un développement durable. In : BARBAULT, R. & CHEVASSUS-AU-LOUIS, B. (dir.), TEYSSEDRE, A., (coord.) : Biodiversité et changements globaux. Enjeux de société et défis pour la recherche. Association pour la diffusion de la pensée française. Ministère des Affaires étrangères, Paris : 192-223. (Ouvrage également publié en anglais).
- 191. BLANDIN, P. 2005.- La biodiversité, héritage pour le futur. In : STENGER, M., (dir.), Planète vie, planète mort, l’heure des choix. Les éditions du Cerf, Paris : 47-55.
- 192. CHEVASSUS-AU-LOUIS, B., BARBAULT, R. & BLANDIN, P., 2005.- Biodiversité, changements globaux et développement durable : de nouveaux concepts pour de nouvelles approches. In : Ligue ROC éd., Pour la biodiversité. Manifeste pour une politique rénovée du patrimoine naturel. A.Venir éditions, Paris : 60-88.
- 202. BLANDIN, P., 2008. Biodiversité, un concept aux mille visages. Quatre-Temps, 32 (1) : 14-15.
- 205. BLANDIN, P., 2008. Les risques liés à l’érosion de la biodiversité. L’Archicube, 4 :92-98.
- 211. BLANDIN, P., 2009a.- De la protection de la nature au pilotage de la biodiversité. Editions Quæ, Versailles : 122 p.
- 214. BLANDIN, P., 2009d.- « Commentaires et propositions sur le plan d’action Agriculture », In : Propositions d’évolution du plan d’action Agriculture (Stratégie Nationale pour la Biodiversité) , CGAAER, rapport n°1819 : 17-31.
- 218. BLANDIN, P., 2010.- Biodiversité. L’avenir du vivant. Collection Albin Michel Sciences. Albin Michel, Paris : 263 p.
- 222. BLANDIN, P., 2010. Homo ethicus. Terre Sauvage, 261 : 65-67.
- 224 BLANDIN, P., 2010. Biodiversité : entre science et éthique. Biofutur, 312 : 61-63.
- 226. BLANDIN, P. & SCHER, O., 2011. Finie l’idéologie de l’équilibre naturel. Espaces naturels 33 : 36-37. www.espaces-naturels.fr
- 227. BLANDIN, P., 2011. Ecology and Biodiversity at the Beginning of the 21st Century : towards a new paradigm ? In: SCHWARZ, A. & JAX, K. (Eds.), Ecology revisited: reflecting on concepts, advancing science. 1st Edition. New York, Springer Publishing Company: chap. 3.3.205-214. www.springerlink.com
- 229. BLANDIN, P., 2011. La planète est confrontée à son premier bouleversement. HDS.mag (Hauts-de-Seine magazine), 16 : 28-29 (propos recueillis par Reine Paris). www.hauts-de-seine.net
- 230. BLANDIN, P., 2011. Les nouveaux enjeux de la biodiversité. In : Les Actes des Etats Généraux de la Chasse « Entre Nature et Futur, Paris, 15 et 16 février 2011. Fédération Nationale des Chasseurs, Paris : 9-11.
- 231. BLANDIN, P., 2011. Pourquoi préserver la biodiversité ? In : Les Monuments historiques, Acteurs du développement durable – 2011. La Demeure Historique 38.
- 235. BLANDIN, P., 2011. Propos recueillis par Guillaume Cottarel. Z’infos Marines, n°2 : 10-13
- 239. BLANDIN, P., 2012. La biodiversité, un enjeu éthique majeur. La Revue de la CFDT, n°106 : 4-12.
- 243. BLANDIN, P., 2012. Biodiversité, une urgence éthique (tribune libre). Sud Ouest, mercredi 2 mai 2012 : 4.
- 244. BLANDIN, P., 2012. How to value Biodiversity and Ecosystem Services: A Long-Standing Argument. In: KING, D. & MERMET, L. (eds.): 2011 World Forum on Enterprise & the Environnement, A Summary of Proceedings: 28-30 June 2011. Oxford, Smith School of Enterprise and the Environnement: 10-11.
- 247. BLANDIN, P., 2012. Protecteurs de la nature, ou responsables de l’évolution? Foi et vie, revue de culture protestante, n°4, décembre 2012: 75-90.
- 248. BLANDIN, P., 2013. Towards EcoEvoEthics. In: BERGANDI, D. (ed.): The Structural Links between Ecology, Evolution and Ethics: The Virtuous Epistemic Circle. Boston Studies in the Philosophy and History of Science, 296, Springer Science+Business Media, Dordrecht: 83-100.
- 249. BLANDIN, P., 2013. La biodiversité, substitut technocratique de la nature? In : BURGAT, F. & NUROCK, V. (éds.) : Le multinaturalisme. Mélanges à Catherine Larrère. Editions Wildproject, Marseille : 54-66.
- 250. BLANDIN, P., 2013. La biodiversité, entre science, éthique et politique. In : La biodiversité. DocSciences, n°16-NOV. 2013 : 2-9.
254. MAUZ, I. & BLANDIN, P., 2014. Savoir environnemental, expertise et décision. In: ZARKA, Y.C. (dir.), Pour un monde habitable. La Terre-Sol. Le monde émergent II. Armand Colin, Paris : 39-58. - 255. BLANDIN, P., 2014. La diversité du vivant avant (et après) la biodiversité: repères historiques et épistémologiques. In : CASSETA, E. & DELORD, J. (dir.) : La biodiversité. Enjeux philosophiques, éthiques et scientifiques. Editions Matériologiques, Paris : 31-68 (e-book).
Développement durable
- 184. BLANDIN, P., 2004g.- Vers une évolution durable de l’anthroposystème. Colloque de prospective « Sociétés et environnements », 5-6 février 2004. INSU/CNRS, Paris : 115-124.
- 185. BLANDIN, P., 2004h.- Développement durable, sciences et patrimoine. Bulletin de l’AMCSTI, 17 : 11-14.
- 190. BLANDIN, P., 2005b.- Développement durable ou adaptabilité durable ? De la nécessité d’une éthique évolutionniste. In : MATAGNE, P. (dir.), Les enjeux du développement durable. L’Harmattan, Paris : 27-45.
206. BLANDIN, P., 2008e.- Les institutions d’histoire naturelle et le développement durable. In : ANONYME, Actes du Symposium International Buffon. Les Muséums et autres institutions naturalistes au XXIe siècle : quel rôle pour un avenir partagé ? Paris, 18-19 octobre 2007. En ligne sur www.mnhn.fr: 18-23 - 208. BLANDIN, P. & GRAFFIN, V., 2008.- The National Museum of Natural History and sustainability : from yesterday to tomorrow. Musées, 27: 102-105.
212. BLANDIN, P., (coord.), 2009b.- Former des acteurs du développement durable. Les défis relevés par le Pôle Développement durable des Chaires UNESCO en France. Commission Nationale Française pour l’UNESCO : 39 p. + annexe, publié en même temps en anglais. - 212 bis. BLANDIN, P. (coord.), 2011. Former des acteurs du développement durable. Les défis relevés par le pôle « Développement durable » des Chaires UNESCO en France (version révisée et augmentée). Commission nationale française pour l’UNESCO, Paris : 72 p. www.unesco.fr
- 238. BLANDIN, P., 2012. L’adaptabilité durable, une nouvelle éthique. Vraiment durable, 1 : 13-32.
- 241. BERGANDI, D. & BLANDIN, P., 2012. De la protection de la nature au développement durable: genèse d’un oxymore éthique et politique. Revue d’Histoire des Sciences, 65-1: 103-142.
- 244. BLANDIN, P., 2012. How to value Biodiversity and Ecosystem Services: A Long-Standing Argument. In: KING, D. & MERMET, L. (eds.): 2011 World Forum on Enterprise & the Environnement, A Summary of Proceedings: 28-30 June 2011. Oxford, Smith School of Enterprise and the Environnement: 10-11.
- 247. BLANDIN, P., 2012. Protecteurs de la nature, ou responsables de l’évolution? Foi et vie, revue de culture protestante, n°4, décembre 2012: 75-90.
248. BLANDIN, P., 2013. Towards EcoEvoEthics. In: BERGANDI, D. (ed.): The Structural Links between Ecology, Evolution and Ethics: The Virtuous Epistemic Circle. Boston Studies in the Philosophy and History of Science, 296, Springer Science+Business Media, Dordrecht: 83-100. - 249. BLANDIN, P., 2013. La biodiversité, substitut technocratique de la nature? In : BURGAT, F. & NUROCK, V. (éds.) : Le multinaturalisme. Mélanges à Catherine Larrère. Editions Wildproject, Marseille : 54-66.
- 250. BLANDIN, P., 2013. La biodiversité, entre science, éthique et politique. In : La biodiversité. DocSciences, n°16-NOV. 2013 : 2-9.
La Grande Galerie de l’Evolution

[dropcap]J[/dropcap]’ai été nommé au Muséum en 1988. Il se trouve que c’est l’année où la décision fut prise, par le Président de la République, de lancer la rénovation de la Galerie de Zoologie. Le magnifique bâtiment, qui abritait les collections de Zoologie, était fermé au public depuis plus de 20 ans, mais les scientifiques du Muséum avaient bien avant engagé des réflexions sur sa rénovation, en particulier en 1976, sous la responsabilité de Francis Petter, du Laboratoire Mammifères et Oiseaux. En 1984, un groupe animé par Alain Foucault, du Laboratoire de Géologie avait proposé des orientations pour la politique d’action culturelle et muséologique du Muséum, qui ont inspiré un texte d’orientation, élaboré en 1986 en vue de la création d’une « Galerie de l’Evolution ». Sur cette base fut établi en 1987 le dossier permettant de lancer un concours de concepteurs. Il fut remporté par les architectes Paul Chemetov et Borja Huidobro, assistés du scénographe et cinéaste René Allio.
Fin 1988, le Muséum avait constitué une « Cellule de préfiguration », dirigée par Michel Van Praët. L’un des thèmes prévus dans le synopsis de la Galerie de l’Evolution était intitulé « Les relations Homme-Nature ». Il avait donné lieu à de nombreux travaux préliminaires, mais rien n’était réellement arrêté. Début 1989, le Directeur du Muséum, le Professeur Philippe Taquet, me demanda d’animer le commissariat scientifique de ce thème, afin d’élaborer un synopsis définitif. Etre ainsi invité à contribuer à la conception de ce thème, au sein de la Galerie de l’Evolution, c’était vraiment une chance exceptionnelle !
Une équipe pluridisciplinaire fut constituée, comprenant des écologues et des représentants des sciences humaines : Claudine Friedberg, anthropologue du Laboratoire Ethobiologie-Biogéographie, Geneviève Humbert, juriste de l’environnement, Laboratoire d’Écologie Générale, et Jean Servan, écologue du laboratoire des Systèmes Naturels et Modifiés. Au titre de la Cellule de Préfiguration, Fabienne Galangau était la muséologue chargée du thème, avec l’appui de Jacques Maigret, spécialiste de biologie marine, et de Francis Petter.

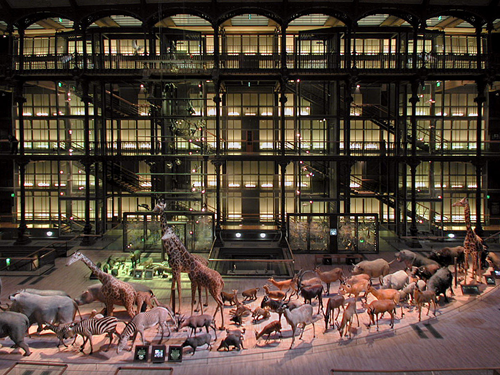
Notre travail s’est appuyé sur la consultation initiale d’une trentaine de personnalités extérieures, et il a bénéficié de l’expertise d’un très grand nombre de scientifiques sollicités sur des points précis. Au cours de nos nombreuses discussions, c’est Michel Van Praët qui introduisit l’expression « l’homme facteur d’évolution », qui allait devenir le titre définitif de « l’Acte 3 » de l’exposition. Un premier synopsis fut produit à la fin de 1989, qui inspira un exposé présenté lors d’un Colloque international organisé fin 1990 (Publication 111). Le synopsis définitif fut rendu en 1991. Avec Fabienne Galangau, j’ai relaté l’histoire de la genèse de cet acte, dans un chapitre d’un livre dirigé par Jacqueline Eidelman et Michel Van Praët, consacré à une analyse de la conception de la Grande Galerie de l’Evolution (Publication 165).
Le défi à relever était clair. Il ne fallait pas faire une exposition «environnementaliste », inventoriant les agressions actuelles à la nature, ni céder à la tentation de tenir un propos culpabilisant. Il s’agissait de montrer par quels processus l’Homme en est venu à influencer l’évolution du monde vivant, et à faire réfléchir les visiteurs sur nos choix pour l’avenir.
L’Acte 3 a été organisé à partir d’une idée simple. Depuis en gros 10 000 ans, les humains transforment la nature, et par conséquent modifient les environnements où évoluent les espèces. Ils interviennent sur la dynamique des populations de certaines espèces exploitées, domestiquent des espèces en sélectionnant des variétés nouvelles, transfèrent volontairement ou non, d’un continent à un autre, ou dans des îles, des espèces qui peuvent profondément modifier les systèmes écologiques où elles s’installent ; ils aménagent les territoires, modifiant et réorganisant les écosystèmes ; ils répandent des polluants. Les systèmes écologiques étant ainsi transformés, souvent profondément, les espèces se trouvent soumises à de nouvelles conditions de sélection, susceptibles de les faire évoluer.
La notion de « biodiversité », lancée par l’ouvrage de Wilson & Peter paru en 1988, fut prise en compte dès 1989 dans l’Acte 3, pour en expliciter la définition et soulever la question de son devenir. Dans une présentation des réflexions sous-tendant notre conception muséologique, faite en 1991 devant le Conseil Général du Génie Rural, des Eaux et des Forêts, je concluais que notre objectif était de faire comprendre que « la bio-diversité, produit de l’évolution est déjà, et désormais sera totalement le produit de la co-évolution homme-nature », chaque citoyen ayant alors à réfléchir au type d’évolution qu’il désire (Publication 112).

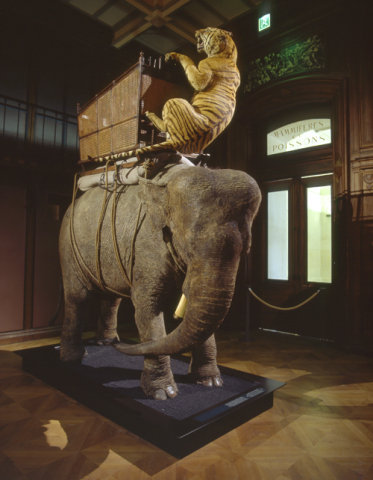
Initialement, l’inauguration de la Galerie de l’Évolution était prévue en 1993, à l’occasion du bicentenaire de la création du Muséum d’Histoire Naturelle par décret de la Convention. Diverses causes provoquèrent des retards, entre autres des difficultés soulevées par le Comité scientifique chargé de donner son avis sur le contenu de l’exposition : la conception de l’Acte 2, où devaient être présentés les mécanismes de l’évolution, était radicalement remise en cause. Un groupe de travail dut élaborer, en six mois, un nouveau contenu, alors que le chantier avançait sur la base du projet antérieur (d’où certaines incohérences dans l’emplacement de certains dispositifs…).
Début 1994, le Directeur du Muséum, le Professeur Jacques Fabriès, me demanda de prendre la direction de la Galerie, avec pour mission d’assurer son lancement et sa mise en exploitation. Pour autant, il n’était pas question que je quitte la direction du laboratoire d’Écologie générale, situé à Brunoy (Essonne).
Diriger un laboratoire de recherche, cela oblige certes à se familiariser avec des tâches administratives auxquelles l’Université ne prépare pas. Toutefois, le développement des activités scientifiques en constitue l’objectif central. Bien peu à voir, de ce fait, avec le pilotage de la Galerie. C’était un nouveau métier car, constituée comme service commun du Muséum, la Grande Galerie de l’Évolution avait les missions suivantes:
- l’accueil des publics dans des expositions permanentes et temporaires;
- la sécurité des biens et des personnes ;
- la maintenance d’un bâtiment sophistiqué sous pilotage informatisé, y compris la zoothèque souterraine ;
- la gestion administrative, dont celle des recettes (billetterie, boutique, locations d’espaces …) et celle des personnels rémunérés sur fonds propres ;
la conservation des collections exposées et la préparation de spécimens pour de nouvelles expositions (ateliers de taxidermie) - la maintenance et l’amélioration de l’exposition permanente ;
- l’organisation des expositions temporaires, des actions pédagogiques (de la petite enfance aux adultes, en passant par les personnes à handicaps), des manifestations culturelles, y compris dans l’espace du Jardin des Plantes ;
- le développement d’un service de documentation spécialisé et des activités éditoriales ;
- le développement d’un service audiovisuel ;
- les relations avec la presse ; la communication et la recherche de partenariats;
une politique de location des espaces ; - le développement de la politique commerciale de la boutique.
En outre, en 1995, le nouveau Directeur du Muséum, le Professeur Henry de Lumley, demanda à la Direction de la Galerie de monter un Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) en Muséologie, ce qui fut fait grâce à l’investissement de plusieurs responsables (services des collections, de l’action pédagogique et culturelle, des expositions, de la documentation) et d’une cellule de recherche en histoire et philosophie des sciences naturelles.
Pour remplir ces missions, la Direction de la Grande Galerie de l’Évolution avait sous sa responsabilité un personnel réparti en plus de 60 fonctions différentes et représentant plus de 120 équivalents temps plein. Les ressources financières, composées d’une subvention de l’État et de ses ressources propres, était d’un montant annuel de l’ordre de 75 000 000 F.
Lors d’un colloque international, à Milan, sur la communication de la science au public, j’ai évoqué les défis auxquels la création de la Grande Galerie de l’Évolution était confrontée, en particulier (publication146 ; voir aussi publication144). Mais il faut se référer au livre dirigé par Jacqueline Eidelman et Michel Van Praët (P.U.F., 2000), fruit d’une véritable recherche en muséologie, pour se rendre compte de ce que fut l’aventure muséologique de la transformation de l’ancienne Galerie de Zoologie en Grande Galerie de l’Évolution.
Pourquoi la Galerie de l’Évolution est devenue « grande » ?
Initialement, la Galerie de Zoologie devait être renommée « Galerie de l’Évolution ». Mais, au dessus de son entrée, on peut lire, gravé dans la pierre : « Grande Galerie ». Un intitulé sans identité, pour la satisfaction de certains responsables du ministère de l’Enseignement Supérieur, réticents à l’idée même d’évolution. C’est en 1994, quelques mois après l’inauguration, que le conseil d’administration du Muséum adopta l’intitulé « Grande Galerie de l’Évolution ».

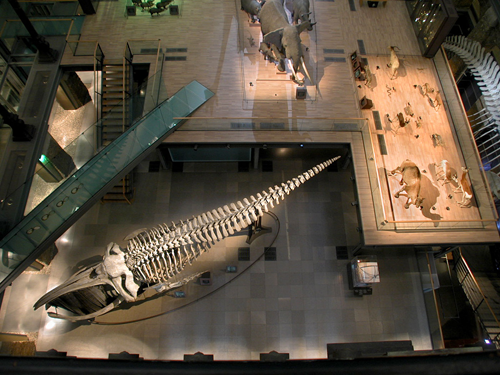

Publications associées
- 111. BLANDIN, P., 1991.- Entre passé et futur, le patrimoine naturel. In: ANONYME, Colloque International 22-23 novembre 1990. La Galerie de l’Evolution, Concepts et Evaluation. Cellule de Préfiguration, Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris : 133-149.
- 112. BLANDIN, P., 1991.- Ecologie et évolution : les responsabilités des hommes. Bulletin du Conseil Général du GREF, n°31, décembre 1991 : 123-130.
- 130bis. BLANDIN, P., 1994.- L’éveil de la Grande Galerie (entretien avec Christine Coste). In : Le muséum national d’histoire naturelle. Beaux Arts Magazine, Hors Série : 24-37.
- 133bis. BLANDIN, P., 1995.- La Grande Galerie de l’Evolution (entretien avec la rédaction). In : Muséum national d’histoire naturelle. Connaissance des Arts, numéro hors série : 20-33.
- 144. BLANDIN, P., 1996.- Les trois défis de la Grande Galerie de l’Evolution. In : MAIRIE DE PARIS, Université d’été : grands projets de l’Etat à Paris. Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris : 46-53.
- 146. BLANDIN, P., 1997.- A permanent exhibition on evolution at the National Museum of Natural History: a scientific and pedagogical challenge. In : ANONYMOUS, The Communication of Science to the Public, Science and the Media. Proceedings of the V International Conference « The Future of Science has begun » Milan, 15-16 février 1996. Fondazione Carlo Erba, Milan: 155 -172.
- 165. BLANDIN, P. & GALANGAU-QUERAT, F., 2000.- Des « Relations Homme-Nature » à « L’Homme, facteur d’évolution »: genèse d’un propos muséal. In : EIDELMAN, J. & VAN PRAET, M. (dir.), La muséologie des sciences et ses publics. Regards croisés sur la Grande Galerie de l’Evolution du Muséum national d’histoire naturelle. Presses Universitaires de France, Paris: 31-51.
- 170. BLANDIN, P., 2002.- The Grande Galerie de l’Evolution (Muséum National d’Histoire Naturelle). In : LORD, G. & LORD, B. (eds.), The Manual of Museum Exhibitions. AltaMira Press, Walnut Creek ,CA : 479-482.
- 176. LANGLOYS, K. & BLANDIN, P., 2003.- Des objets en plastique dans les collections d’histoire naturelle ? In : PELLEGRINI, B., (dir.), Sciences au musée, sciences nomades. Georg Editeur, Chêne-Bourg/Genève : 49-59.

Le bois de Païolive

[dropcap]E[/dropcap]n 1964, avec un camarade de l’ENS, Jacques Balandreau, ardéchois d’Annonay, je suis allé découvrir l’Ardèche méridionale. A l’aide d’une carte géologique, nous avions choisi de camper près du village de Brahic, au coeur d’une zone à grande diversité stratigraphique et pétrographique, entre les Cévennes de schistes et gneiss, royaume sévère du châtaignier, et de vastes étendues calcaires à l’ambiance méditerranéenne. C’est là que se trouve le bois de Païolive, entouré de plateaux appelés les « Gras ». C’est un site extraordinaire, un immense karst traversé par les gorges du Chassesac. Entremêlement de formes rocheuses étonnantes et d’une végétation embrouillée, difficilement pénétrable, ce vaste complexe écologique héberge une flore et une faune d’une remarquable diversité. Un magnifique coléoptère, la Cétoine bleue, est devenu l’emblème de Païolive. Des cheminements balisés permettent de belles découvertes, et les touristes amoureux de nature sont nombreux à les suivre.
L’association Païolive, fondée en 2004, a pour objectif l’étude pluridisciplinaire de ce site, sa protection, la diffusion des connaissances, la sensibilisation des usagers, et l’éducation. J’ai été l’un des membres du Comité de parrainage. A sa fondation, l’association avait rédigé un manifeste à forte dimension éthique. Le 30 octobre 2010, une réunion à laquelle j’ai participé permit de constater que l’association pouvait s’inscrire dans la dynamique de l’Initiative pour une Éthique de la Biosphère. Il a été décidé d’écrire un nouveau manifeste faisant explicitement référence à l’Initiative ; ce nouveau texte a été adopté en assemblée générale le 28 janvier 2012.
L’association Païolive a mis en œuvre un programme de recherches interdisciplinaires, qui a déjà donné lieu à de nombreuses publications, en particulier le volumineux n°1 des Cahiers de Païolive, publié en 2008. Un nouveau bilan des recherches naturalistes a été effectué lors d’une réunion le 2 février 2011, qui a fait ressortir de nombreuses avancées dans l’inventaire de la biodiversité, dont l’importance est liée à la complexité écologique du site et à sa position à la confluence de différentes influences climatiques
Mission Pérou, septembre-octobre 2011

[dropcap]P[/dropcap]oursuivant ses recherches sur les Morphos du Nord-Est du Pérou, Patrick Blandin est en mission sur le terrain entre le 13 septembre et le 20 octobre 2011.
Les prospections sont menées dans la région de Tarapoto et dans celle de Moyobamba (département San Martin). Un accord a été passé avec l’ONG péruvienne Ecosistemas Andinos ECOAN, qui se préoccupe de conservation de la nature dans les Andes, pour séjourner dans la station d’Abra Patricia, à 2300 m dans le département Amazonas. Il s’agit d’une réserve privée, très bien équipée, en particulier pour l’accueil des ornithologues. Avec Gilbert Lachaume, il est prévu de commencer un inventaire de la faune de papillons de la « cloud forest » dans cette réserve, au coeur d’une région stratégique d’un point de vue biogéographique.
22 septembre 2011. Session d’observation de l’activité des Morphos le long du rio Cumbaza, près de Tarapoto. Tous les Morphos observés volant dans une section du rio sont notés. Après une pluie, le temps s’est levé, et l’activité a commencé vers 9 heures. En un peu moins de 4 heures, plus de 100 passages ont été notés, et sept espèces ont été observées. Quelques spécimens sont capturés, photographiés et relâchés. Le cas échéant, certains sont conservés pour mise en collection. Ces observations permettent d’évaluer l’état de la faune locale, et contribuent à la connaissance des heures d’activité des espèces.

Le Pérou

[dropcap]D[/dropcap]epuis 2005, je me rends au Pérou avec mon collègue entomologiste Gilbert Lachaume, au moins une fois par an, pour étudier la diversité des papillons dans la région du nord-est des Andes. Le choix de cette région ne s’est pas fait au hasard. D’après ce que j’en savais, au travers de mes études sur les Morphinae, il était évident que c’était une zone posant des problèmes de biogéographie assez compliqués, et en vérité très mal connue. Cependant Gilbert Lachaume était en relation depuis longtemps avec un collecteur local, Benigno Calderón, qui lui avait régulièrement fourni des spécimens intéressants ; en outre Gilbert s’était rendu dans la région quelques années auparavant, et y avait quelques contacts.
Nous n’avons pas été déçus ! La faune de papillons recelait bien des surprises, qu’il s’agisse de taxons nouveaux ou de questions de répartition géographique. En même temps, nous avons découvert une belle région, où les Andes orientales viennent s’achever au bord de la plaine amazonienne. Une région habitée de très longue date : le département Amazonas recèle des sites archéologiques étonnants et encore peu connus, témoins d’une civilisation antérieure aux Incas. Et une région aujourd’hui confrontée à de difficiles problèmes socio-économiques, qui ont de graves répercussions en matière de conservation de la nature.
1. LE PÉROU NORD-ORIENTAL : GRANDS TRAITS GÉOGRAPHIQUES
Au nord du Chili, la Bolivie et le Pérou recouvrent les Andes centrales, dont la formation a commencé avant celle des Andes septentrionales d’Equateur, de Colombie et du Venezuela. Le Pérou nord-oriental forme un vaste ensemble géographique qui s’étend, d’ouest en est, de la vallée du Marañon aux plaines de l’ouest amazonien. Les Andes y sont « coupées » par deux grandes vallées sud-nord, celle du Marañon et, plus à l’est, celle du Huallaga. Sorti des Andes, le Marañon tourne vers l’est et reçoit, en rive droite, divers affluents, dont le Huallaga est le premier vraiment important. Une dernière cordillère, la Cordillera Azul, sépare le Huallaga de l’Ucayali, une autre grande rivière coulant également du sud au nord pour rejoindre aussi le Marañon.
Entre Marañon et Huallaga s’étend un axe montagneux complexe, profondément cisaillé par leurs affluents. Ceux du Marañon, en rive droite, coulent en gros du sud-est au nord-ouest. Ceux du Huallaga, en rive gauche, coulent à l’inverse du nord-ouest au sud-est.
Le Huallaga, avant d’atteindre la plaine amazonienne et de rejoindre le Marañon, coupe un axe montagneux orienté nord-ouest – sud-est, appelé « La Escalera ». Auparavant, il reçoit en rive gauche les eaux du río Mayo et, en remontant son cours, successivement celles des ríos Sisa, Saposoa et Huayabamba, en rive droite celles des ríos Ponasa et Biabo.
D’ouest en est, quelques villes importantes structurent la vie de la région : Jaén, à l’ouest du Marañon, dans le département de Cajamarca ; Chachapoyas, le chef-lieu du département Amazonas, retiré dans la vallée du río Utcubamba, affluent en rive droite du Marañon ; Moyobamba, chef-lieu du département San Martín, dans la vallée du río Mayo ; Tarapoto, non loin du confluent du Mayo avec le Huallaga ; Juanjuí, enfin, à une centaine de kilomètres en amont de Tarapoto dans la vallée du Huallaga. Bien plus au sud (400 km environ), se trouve Tingo María, localité bien connue des lépidoptéristes, car centre de collecte et d’expédition depuis un demi-siècle. De Juanjuí à Tingo María, la route est déconseillée, pour des raisons d’insécurité. Au nord de Tarapoto, dans la plaine amazonienne, la ville de Yurimaguas, sur le Huallaga, est encore loin de celle d’Iquitos.
L’axe Jaén – Moyobamba – Tarapoto est parcouru par une route asphaltée importante, qui relie la côte à l’intérieur. De Tarapoto partent deux routes asphaltées, l’une vers Juanjuí, l’autre vers Yurimaguas. Bénéficiant d’un aéroport moderne, Tarapoto est le cœur économique de la région.
Le Pérou nord-oriental offre une grande diversité écologique, du fait des altitudes qui s’étagent de moins de 200 m à plus de 4000 m, et de l’effet d’écran que créent les axes montagneux vis-à-vis des vents apportant les nuages formés au dessus du bassin amazonien. En conséquence, on rencontre aussi bien des zones au climat aride que des zones à très forte pluviosité. Il en résulte une grande variété d’écosystèmes, depuis les matorrals à cactus de la moyenne vallée du Marañon, ou les « bosques secos » de celle du Huallaga, jusqu’aux forêts pluviales de type amazonien, vers Yurimaguas, en passant par les « bosques de neblina », forêts hyperhumides qui se développent entre 1800 et 3500 m, approximativement, en particulier dans la région de l’Alto Mayo, où un vaste ensemble est protégé (en principe).

Le nord du Pérou. Altitudes : en vert : altitudes inférieures à 500 m ; en jaune pâle : entre 500 et 1000 m ; en jaune vif : entre 1000 et 2000 m ; en rose très pâle : entre 2000 et 3000 m ; en mauve : entre 3000 et 4000 m : en mauve plus foncé : plus de 4000 m.
2. LA DIVERSITE DES LEPIDOPTERES DANS LE NORD-EST DU PEROU
Le projet a été initialement soutenu par le Programme Pluri-Formations « Etat et structure phylogénétique de la biodiversité actuelle et fossile » du Muséum National d’Histoire Naturelle. Depuis 2008, nous finançons personnellement nos missions, qui restent officielles dans le cadre d’ordres de mission « sans frais » du Muséum. En 2007, le Muséum a également contribué à une mission d’une doctorante, Catherine Cassildé, qui préparait une thèse sur l’évolution des espèces du genre Morpho, soutenue en 2009.
Le projet est mené en collaboration avec le Dr. Gerardo Lamas, chef du département d’entomologie du Muséum de Lima, dans le cadre d’une convention de collaboration entre les Muséums de Paris et Lima. Nous collaborons également avec l’équipe de Jean-François Silvain (IRD-CNRS, Gif-sur-Yvette), qui réalise des analyses moléculaires en vue de préciser les relations phylogénétiques entre certains taxons. Sur place, à Tarapoto, nous bénéficions de l’aide de Stéphanie Gallusser, qui a fait une thèse sur des Lépidoptères de la région, et de César Ramirez, son mari, agronome péruvien (photo 20). En outre, des collecteurs locaux travaillent pour nous.
L’objectif général est de contribuer à l’inventaire des Lépidoptères diurnes, essentiellement dans les Départements San Martín, Amazonas et Cajamarca, et de préciser les répartitions géographiques de certaines d’entre elles, en vue de comprendre leur évolution.
Les recherches portent principalement sur la sous-famille des Morphinae, qui comprend le genre Morpho et la tribu des Brassolini, dont font partie les « papillons-chouettes », lesquels portent comme de grands yeux dessinés au revers de leurs ailes (genre Caligo). Nous collectons des spécimens d’autres groupes, en particulier des Ithomiini, dont Gerardo Lamas est spécialiste. Les spécimens recueillis sont répartis entre le Muséum de Lima et le Muséum de Paris.
Inventaire des espèces et sous-espèces de Morphinae
L’inventaire des Morphinae peut être considéré comme achevé, et sera prochainement publié, une fois certains problèmes de nomenclature résolus.
Le nord-est du Pérou, apparaît comme la région des Andes tropicales (de la Bolivie au Venezuela) la plus riche en espèces du genre Morpho. Des sous-espèces nouvelles ont été décrites (Publications193, 196), et j’ai publié la liste des espèces connues de la forêt protégée de l’Alto Mayo, dans le document officiel de gestion de cette région menacée (Publication204). Les informations recueillies lors des missions de 2005, 2006 et 2007 ont en outre été incorporées dans mes ouvrages sur le Genre Morpho (Publications198, 199). (Photo21, 22 : M. amphitryon duchenei, M. aurora lamasi).
Les Brassolini sont également plus diversifiés que partout ailleurs dans les Andes tropicales. La liste des espèces ne pourra toutefois être établie qu’après la résolution de problèmes taxonomiques assez complexes dans le genre Opsiphanes. Les Antirrhaeini nécessitent également une clarification de leur systématique.
Biogéographie
Les données disponibles avant le démarrage du projet montraient que la faune de forêt de plaine (« selva baja ») du haut río Huallaga, dans la région de Tingo María (presque 500 km au sud du débouché du fleuve dans la plaine amazonienne) diffèrent notablement de celle de la plaine : des espèces manquent, d’autres sont représentées par des sous-espèces différentes.
Nous avons mis en évidence une large zone de transition entre la faune de plaine et celle de l’amont de la vallée du Huallaga, entre Tarapoto et Juanjuí, avec chez certaines espèces, des populations aux caractéristiques « en moyenne » intermédiaires, en réalité souvent très polymorphes. Ce phénomène affecte aussi bien certaines espèces de Morpho que plusieurs espèces de Brassolini.
La dernière mission (début 2010), à l’occasion de laquelle de nouvelles localités ont été prospectées, nous a réservé quelques surprises. La configuration géographique de la zone de transition se révèle plus complexe que nous ne le pensions ! Affaire à suivre…
Problèmes d’évolution
Dans la forêt des nuages vole une « espèce » du genre Morpho, M. sulkowskyi, objet de débat entre Gerardo Lamas, du Muséum de Lima, et moi. Nous avons décrit ensemble deux « sous-espèces », M. sulkowskyi nieva Lamas & Blandin, 2007 et M. sulkowskyi calderoni Blandin & Lamas, 2007, très différentes. M. sulkowskyi existe de la Bolivie à la Colombie, et le débat porte sur la question de savoir s’il s’agit d’une seule espèce, ou de deux. (Photos 23, 24, 25, 26 : les 2 sous-espèces, mâles et femelles)
Nous avons réuni des données très précises – et excitantes ! – sur la répartition géographique de nieva et de calderoni. Et voilà qu’un entomologiste allemand vient de décrire, fin 2009, une troisième sous-espèce de la région ! Nous avons pu l’échantillonner. Le séquençage de gènes mitochondriaux ouvre de bien intéressantes perspectives pour interpréter l’évolution de ces passionnants papillons, si beaux à voir voler lorsqu’il ne pleut pas et qu’un peu de soleil perce les nuages accrochés à la montagne. Une publication est en préparation. (Photo 27 : paysage du haut rio Nieva)
Un autre groupe de Morpho pose des problèmes d’évolution assez perturbants. Il s’agit de M. menelaus, bien connu en Guyane, et représenté près de Tarapoto par une très belle sous-espèce, M. m. occidentalis. Cette forme de plaine vole en fait jusque vers 900 m dans La Escalera. Dans l’Alto Mayo, on trouve une espèce voisine, M. godartii julanthiscus, en gros à partir de 800-900 m et jusque vers 1400-1500 m. Pas de confusion possible… habituellement. Mais nous avons découvert près du village de Lamas, vers 700 m, une population dont les individus présentent des caractères intermédiaires ! Et nous voici cherchant à comparer le plus de populations possibles, de différentes localités, y compris d’autres régions des Andes et du bassin amazonien. L’étude est en cours, avec là encore l’analyse des séquences de gènes mitochondriaux. Mes tentatives d’interprétation sont bousculées les unes après le autres, au fur et à mesure que des données nouvelles sont engrangées : l’évolution de ces taxons, le long des Andes, est d’une complexité inattendue. (Photos 28, 29, 30, 31 : mâles et femelles de occidentalis et de julanthiscus)
Il y a peu de décennies, on cherchait à interpréter la diversification des flores et des faunes amazoniennes en faisant appel aux variations climatiques de l’Ere Quaternaire. J’ai moi-même été influencé par ce que l’on appelait à l’époque la théorie des « refuges forestiers » (Publications). Aujourd’hui, il est évident que l’on ne peut se passer d’une compréhension de l’histoire de la formation des Andes, du bassin amazonien et des différents types de forêts. Il existe sur ces questions une riche bibliographie géologique et paléontologique, mais peu de travaux synthétiques. L’entomologiste doit devenir (un peu !) géologue.
Biologie des Morpho
César Ramirez passe des heures en forêt, l’œil aux aguets, scrutant la végétation pour trouver des chenilles, des chrysalides, voire des œufs de Morpho. Et il trouve. Bon botaniste, il sait reconnaître les plantes hôtes des chenilles (en général des arbustes, ou des arbres). Un jour, il a observé une femelle de Morpho telemachus en train de pondre. Avec Stéphanie Gallusser, il a élevé les chenilles et obtenus des adultes ; les résultats viennent d’être publiés (Publication220).
D’autres espèces sont en cours d’étude. (Photo 32 : César Ramirez travaillant à l’élevage de chenilles de Morpho)
Dans la vallée du río Shilcayo, tout près de Tarapoto, nous avons fait construire un mirador permettant d’observer l’activité des papillons le long des rives (Photo 33 : mirador). Catherine Cassildé a ainsi fait une étude des horaires d’activité et des types de vol de plusieurs espèces de Morpho (Photo 34 : C. Cassildé en observation). Elle a ainsi disposé pour sa thèse d’informations précises sur les comportements, dont elle a pu discuter l’utilisation en phylogénie.
Publications associées
- 193. BLANDIN, P., 2006.- Deux nouvelles sous-espèces péruviennes de Morpho (Balachowskyna) aurora Westwood, 1851 (Lepidoptera, Nymphalidae). Bulletin de la Société entomologique de France, 111 (3) : 321-325.
- 196. BLANDIN, P. & LAMAS, G., 2007 [2006].- Five new Peruvian subspecies of Morpho (Lepidoptera : Nymphalidae, Morphinae). Revista peruana de Entomología, 45 : 65-70.
- 198. BLANDIN, P., 2007.- The Systematics of the Genus Morpho Fabricius, 1807. Hillside Books, Canterbury: 277 p.
- 199. BLANDIN, P., 2007.- The Genus Morpho, Lepidoptera Nymphalidae, Part 3. Addenda to Part 1 and Part 2 & The Subgenera Pessonia, Grasseia, and Morpho. Hillside Books, Canterbury: I-XI, 99-237, 444 figs.
- 204. BLANDIN, P., 2008.- Las mariposas azules del Alto Mayo : el género Morpho Fabricius, 1807 (Lepidoptera : Nymphalidae, Morphinae). In : ANONIMO, Plan Maestro del Bosque de Protección Alto Mayo 2008-2013. INRENA, Lima: 247-250.
- 220. GALLUSSER, S., RAMIREZ, C. & BLANDIN, P., 2010.- Observaciones sobre el desarollo y polimorfismo de Morpho (Iphimideia) telemachus (Linnaeus, 1758) en el noreste Peruano (Lepidoptera, Nymphalidae, Morphinae). Bulletin de la Société entomologique de France, 115(1) : 5-15.
- 221. CASSILDÉ, BLANDIN, PIERRE & BOURGOIN; 2010. Phylogeny of the genus Morpho Fabricius, 1807, revisited (Lepidoptera, Nymphalidae).Bulletin de la Société entomologique de France, 115 (2) – 225-250.
- 240. CASSILDE, C., BLANDIN, P. & SILVAIN, J.F., 2012. Phylogeny of the genus Morpho Fabricius, 1807: insights from two mitochondrial genes (Lepidoptera: Nymphalidae). Annales de la Société entomologique de France, 48(1-2): 173-188.
- 251. BLANDIN, P. & PURSER, B., 2013. Evolution and diversification of Neotropical butterflies: insights from the biogeography and phylogenhy of the genus Morpho Fabricius, 1807 (Nymphalidae: Morphinae), with a review of the geodynamics of South America. Tropical Lepidoptera Research, 23(2): 62-85.
- 252. BLANDIN, P., BRISTOW, R., NEILD, A., de SOUSA, J.C., GARECA, Y. & HUERTAS, B., 2014. Revisiting the Andean butterfly Eryphanis zolvizora group (Lepidoptera, Nymphalidae): one or several species? European Journal of Taxonomy, 71: 1-66.
- 256. BLANDIN, P., RAMIREZ, C., GALLUSSER, S. & LACHAUME, G., 2014. Premières observations sur la chenille de Morpho achilles : comparaison avec Morpho helenor et Morpho granadensis (Lepidoptera: Nymphalidae: Morphinae). Bulletin de la Société entomologique de France, 119 (3) : 323-328.
- 257. BLANDIN, P. & LACHAUME, G., 2014. La découverte des Morpho dans le Pérou septentrional, de la fin du XIXe au début du XXIe siècle. Antenor, 1 (2) : 199-261.
- 258. RAMIREZ GARCIA, C., GALLUSSER, S., LACHAUME, G. & BLANDIN. P., 2014. The ecology and life cycle of the Amazonian Morpho (Laurschwartzia) cisseis phanodemus Hewitson, 1869, with a comparative review of early stages in the genus Morpho (Lepidoptera: Nymphalidae: Morphinae). Tropical Lepidoptera Research, 24(2) : 67-80.
3. DEFORESTATION ET CONSERVATION DE LA NATURE
Dans le département San Martín, de nombreuses régions sont largement déboisées, en particulier dans la zone des forêts sèches, entre Tarapoto et Juanjuí notamment. Les forêts plus humides le sont également dans bien des endroits. En revanche, les forêts de l’Alto Mayo, qui s’étagent entre 800 m et plus de 3000 m l’étaient peu il y a moins de 20 ans. La construction de la route reliant les villes de la côte Pacifique à Tarapoto, à la fin des années 1990, a favorisé une importante migration de paysans pauvres venant principalement du département Cajamarca. Ces personnes ont commencé à s’installer illégalement dans la forêt de protection de l’Alto Mayo. Le déboisement va bon train, comme nous avons pu le constater en 2007 dans la vallée du río Yuracyacu : pâturages, arbres morts sur pied, concert de tronçonneuses… nous étions dans le « bosque de destrucción », et non dans le « bosque de protección », ironisa tristement un professeur du collège de Soritor, qui nous accompagnait. Que faire ? Une personne très impliquée dans la conservation de la nature en arrivait à se demander s’il ne faudrait pas faire appel à l’armée pour déloger toutes ces familles ! Sans doute faudrait-il mieux imaginer d’autres solutions, permettant aux familles de vivre tout en maintenant des espaces forestiers importants.
4. CREATION D’UNE AFFICHE EDUCATIVE POUR LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DU SAN MARTIN
Avec Gilbert Lachaume, j’ai visité le collège de Soritor en mars 2008. Nous avons admiré leur engagement à enseigner la biologie et à sensibiliser leurs élèves à la conservation de la nature, en particulier en leur faisant élever des chenilles pour étudier le cycle de développement des papillons.
En discutant, il nous est venu l’idée de faire des documents éducatifs pour sensibiliser les élèves à l’extraordinaire biodiversité de leur région. A notre retour, nous en avons parlé à Louis Albert de Broglie, qui a relancé la tradition de la maison Deyrolle, éditrice depuis le 19e siècle d’affiches pédagogiques : « Deyrolle pour l’Avenir » crée et diffuse des affiches d’éducation à l’environnement. L’idée de réaliser une affiche sur la biodiversité du nord-est du Pérou et de l’offrir aux écoles de cette région a été accueillie avec enthousiasme. Mais il fallait trouver un imprimeur au Pérou !
En novembre 2008, à notre hôtel, une conversation s’engage avec une famille péruvienne, apparemment en vacance. Les parents nous expliquent qu’ils sont de Lima et que des amis leur avaient offert un petit singe. Ils pensèrent qu’il serait mieux dans son milieu naturel ; renseignements pris, le singe provenait de l’Alto Mayo. Et voilà la famille, venue pour remettre l’animal à une association spécialisée, qui découvre pour la première fois le côté amazonien de leur pays, et prend conscience des menaces pesant sur la forêt.
Et vous, que faites-vous au Pérou ? nous demandent-ils. Nous expliquons nos recherches.
– Ah, que c’est bien que vous veniez ainsi contribuer à mieux connaître les richesses naturelles de notre pays…nous serions heureux faire quelque chose pour vous aider.
– Que faites-vous ?
– Nous sommes imprimeurs.
Nous leur parlons de notre projet. Ils nous proposent d’imprimer gracieusement 1000 affiches. C’est ainsi que notre idée a pu se concrétiser en mars 2010. Entre temps, il avait fallu décider du contenu de l’affiche (choix des espèces à représenter, textes), le faire valider par des collègues du Muséum de Lima et par le représentant d’une ONG se consacrant à la conservation des écosystèmes andins. L’illustration a été réalisée par l’artiste naturaliste Gaëtan du Chatenay, la maquette finalisée sous la direction de « Deyrolle pour l’avenir ». Par ailleurs, en novembre 2009, contact avait été pris avec les autorités départementales de l’éducation nationale, qui donnèrent leur accord pour la distribution de l’affiche dans tous les collèges et toutes les écoles du San Martín. Les imprimeurs ont dû se procurer le papier écocertifié au Chili. Après quelques angoisses liées au transport par route des affiches de Lima à Tarapoto (également offert par les imprimeurs), les affiches nous sont parvenues juste à temps, avant notre départ, pour que nous puissions les remettre, d’abord aux responsables départementaux, puis les distribuer à tous les directeurs de collèges et d’écoles. Nous avons en outre rédigé un petit texte d’accompagnement, destiné à faciliter l’exploitation de l’affiche par les enseignants.
CHECKLIST DU GENRE MORPHO Fabricius, 1807

Des erreurs commises dans la précédente liste ont été corrigées. Merci de me signaler toute erreur qui subsisterait. Je serais heureux de tout commentaire et de recevoir des informations sur des taxons nouveaux dont je n’aurais pas eu connaissance.
La liste est basée sur l’ouvrage The Systematics of the Genus Morpho Fabricius, 1807 (Blandin, 2007). Elle a été complétée en y ajoutant de nombreuses sous-espèces décrites depuis la parution de cet ouvrage. Elle a été modifiée suite à de récentes études phylogénétiques (Cassildé et al., 2010 ; Cassildé et al., 2012 ; Penz et al., 2012). Cassildé et al. (2010) ont montré que les espèces M. marcus et M. eugenia doivent être séparées du sous-genre Cytheritis, pour former un nouveau sous-genre, Deyrollia Cassildé & Blandin, 2010. Les études phylogéntiques montrent aussi que les sous-genres Cytheritis (sensu stricto) et Balachowskyna sont proches : Balachwskyna et ici traité comme synonyme plus récent de Cytheritis sensu stricto. De même, le sous-genre Pessonia est considéré comme synonyme plus récent de Morpho (sensu stricto), conformément à Penz et al. (2012) et Blandin & Purser (2013). L’ordre des sous-genres a été modifié, en relation avec la succession plausible des divergences dans l’arbre phylogénétique (voir Blandin & Purser, 3013). Par ailleurs, les résultats obtenus par Cassildé et al. (2012) ont confirmé la séparation de M. sulkowskyi et de M. lympharis, telle que proposée par Lamas (2004).
Au sein de chaque sous-genre, l’espèce-type est placée en premier, suivie par les autres espèces dans l’ordre chronologique de description. Les sous-espèces sont citées dans l’ordre chronologique des descriptions.
Pour les synonymies, voir Lamas (2004) et Blandin (2007). Les sous-espèces récemment décrites devront faire l’objet de révisions critiques, et plusieurs mises en synonymie ne sont pas exclues.
Errors in the previous list have been corrected. I shall be happy for any comment, correction, and information about new taxa.
The list is based on the book The systematics of the genus Morpho Fabricius, 1807 (Blandin, 2007). It has been completed by many subspecies described after the publication of this book, and modified according to recent phylogenetic studies (Cassildé et al., 2010; Cassildé et al., 2012; Penz et al., 2012). Cassildé et al. (2010) showed that M. marcus and M. eugenia should be separated from the subgenus Cytheritis: they form a new subgenus, Deyrollia Cassildé & Blandin, 2010. Phylogenetic studies also showed that the subgenera Cytheritis (sensu stricto) and Balachowskyna are closely related: here, Balachowskyna is considered as a junior synonym of Cytheritis. Similarly, the subgenus Pessonia is considered as a junior synonym of Morpho (sensu stricto), according to Penz et al. (2012) and Blandin & Purser (2013). The subgenera order in the list has been modified, in relation with the plausible chronological sequence of divergences in the phylogenetic tree (see Blandin & Purser, 2013). Moreover, results obtained by Cassildé et al. (2012) confirmed the separation of M. sulkowskyi and M. lympharis, as proposed by Lamas (2004).
Within each subgenus, the type-species is presented first, and followed by others in chronological order of description. The subspecies are listed in chronological order of description.
For synonymies, see Lamas (2004) and Blandin (2007). Recently described subspecies must be critically revised, and several synonymies are probable.
REFERENCES
LAMAS, G., 2004. Morphinae. Tribe Morphini. In LAMAS, G. (ed.). Checklist: Part 4A. Hesperioidea – Papilionoidea. In HEPPNER, J.B. (ed.): Atlas of Neotropical Lepidoptera. Association for Tropical Lepidoptera, Scientific Publishers, Gainesville, Florida, USA: 192-201.
BLANDIN, P., 2007. The systematics of the genus Morpho Fabricius, 1807 (Lepidoptera, Nymphalidae, Morphinae). Hillside Books, Canterbury, UK: 277 p.
CASSILDE, C., BLANDIN, P., PIERRE, J. & BOURGOIN, T., 2010. Phylogeny of the genus Morpho Fabricius, 1807 (Lepidoptera, Nymphalidae), revisited. Bulletin de la Société entomologique de France, 115: 225-250.
CASSILDE, C., BLANDIN, P. & SILVAIN, J.F., 2012. Phylogeny of the genus Morpho Fabricius, 1807: insights from two mitochondrial genes (Lepidoptera: Nymphalidae). Annales de la Société entomologique de France, (n.s.), 48: 173-188.
PENZ, C., DEVRIES, P.J. & WAHLBERG, N., 2012. Diversification of Morpho butterfies (Lepidoptera, Nymphalidae): a re-evaluation of morphological characters and new insight from DNA sequence data. Systematic Entomology, 37: 670-685.
BLANDIN, P. & PURSER, B., 2013. Evolution and diversification of Neotropical butterflies: insights from the biogeography and phylogeny of the genus Morpho Fabricius, 1807 (Nymphalidae: Morphinae), with a review of the geodynamics of South America. Tropical Lepidoptera Research, 23(2): 62-85.
Sous-genre Deyrollia Cassildé & Blandin, 2010
Morpho (Deyrollia) marcus (Schaller, 1785)
1. M. marcus marcus (Schaller, 1785)
2. M. marcus major Lathy, 1905
3. M. marcus intermedia Kaye, 1917
Morpho (Deyrollia) eugenia Deyrolle, 1860
1. Morpho eugenia eugenia Deyrolle, 1860
2. Morpho eugenia uraneis H.W. Bates, 1865
Sous-genre Iphimedeia Fruhstorfer, 1912
Morpho (Iphimedeia) hercules (Dalman, 1823)
1. M. hercules hercules (Dalman, 1823)
2. M. hercules diadema Fruhstorfer, 1905
3. M. hercules itatiaya Weber, 1944
Morpho (Iphimedeia) telemachus (Linnaeus, 1758)
1. M. telemachus telemachus (Linnaeus, 1758)
2. M. telemachus iphiclus C. Felder & R. Felder, 1862
3. M. telemachus richardus Fruhstorfer, 1898
4. M. telemachus foucheri Le Moult, 1926
5. M. telemachus lilianae Le Moult, 1927
6. M. telemachus martini Niepelt, 1933
7. M. telemachus exsusarion Le Moult & Réal, 1962
8. M. telemachus penelope Weber, 1963 (in part)
9. M. telemachus jorgei Blandin 2007
10. M. telemachus athena Schäffler & Frankenbach, 2008
11. M. telemachus persephone Schäffler & Frankenbach, 2008
12. M. telemachus jongerlingi Schäffler & Frankenbach, 2009
13. M. telemachus lutzi Schäffler & Frankenbach, 2009
Morpho (Iphimedeia) theseus Deyrolle, 1860
1. M. theseus theseus Deyrolle, 1860
2. M. theseus justitiae Salvin & Godman, 1868
3. M. theseus juturna Butler, 1870
4. M. theseus aquarius Butler, 1872
5. M. theseus yaritanus Fruhstorfer, 1912
6. M. theseus heraldica Niepelt, 1927
7. M. theseus oaxacensis Le Moult & Réal, 1962
8. M. theseus triangulifera Le Moult & Réal, 1962
9. M. theseus schweizeri (R.F. Maza, 1987)
10. M. theseus perlmani Neild, 2001
11. M. theseus utae Schäffler, 2007
12. M. theseus claritae Neild, 2008
13. M. theseus xena Schäffler & Frankenbach, 2008
14. M. theseus mazatecus Jakubek & Fisher, 2009
15. M. theseus cocoliensis Jongerling, 2009
16. M. theseus dariensis Jongerling, 2009
17. M. theseus bugaensis Schäffler & Frankenbach, 2009
18. M. theseus neoescalantei Schäffler & Frankenbach, 2009
19. M. theseus chirripoensis Schäffler, Frankenbach & Dufek, 2011
Morpho (Iphimedeia) amphitryon Staudinger, 1887
1. M. amphitryon amphitryon Staudinger, 1887
2. M. amphitryon susarion Fruhstorfer, 1912
3. M. amphitryon cinereus Duchêne, 1985
4. M. amphitryon duponti Duchêne, 1989
5. M. amphitryon duchenei Blandin & Lamas, 2007
6. M. amphitryon attali Blandin 2007
7. M. amphitryon lisethi Schäffler & Frankenbach, 2008
8. M. amphitryon azurita Duchêne & Blandin, 2009
Morpho (Iphimedeia) niepelti Röber, 1927
Sous-genre Laurschwartzia Blandin, 2007
(nom de substitution pour le sous-genre Schwartzia Blandin, 1988, préoccupé)
Morpho (Laurschwartzia) hecuba (Linnaeus, 1771)
1. M. hecuba hecuba (Linnaeus, 1771)
2. M. hecuba obidonus Fruhstorfer, 1905
3. M. hecuba polyidos Fruhstorfer, 1912
4. M. hecuba werneri Hopp, 1921
Morpho (Laurschwartzia) cisseis C. Felder & R. Felder, 1860
1. M. cisseis cisseis C. Felder & R. Felder, 1860
2. M. cisseis phanodemus Hewitson, 1869
3. M. cisseis cisseistricta Le Moult & Réal, 1962
4. M. cisseis gahua Blandin, 1988
5. M. cisseis jeannoti Blandin & Lamas, 2007
6. M. cisseis cabrera Blandin & Lamas, 2007
7. M. cisseis rumbucheri Schäffler & Frankenbach, 2009
8. M. cisseis rondoniensis Jongerling, 2010
Sous-genre Iphixibia Le Moult & Réal, 1962
Morpho (Iphixibia) anaxibia (Esper, [1801])
Sous-genre Megamede Hübner, [1819]
Morpho (Megamede) rhetenor (Cramer, 1775)
1. M. rhetenor rhetenor (Cramer, 1775)
2. M. rhetenor cacica Staudinger, 1876
3. M. rhetenor helena Staudinger, 1890
4. M. helenor columbianus E. Krüger, 1925
5. M. rhetenor augustinae Le Cerf, 1925
6. M. rhetenor equatenor Le Moult & Réal, 1962
7. M. rhetenor tello Blandin, 2007
8. M. rhetenor mariajosianae Blandin, 2008
9. M. rhetenor hightoni Neild, 2008
Morpho (Megamede) cypris Westwood, 1851
1. M. cypris cypris Westwood, 1851
4. M. cypris bugaba Staudinger, 1887
2. M. cypris chrysonicus Fruhstorfer, 1913
5. M. cypris aphrodite Le Moult & Réal, 1962
3. M. cypris smalli Blandin, 2007
6. M. cypris johnsoni Schäffler & Frankenbach, 2009
7. M. cypris limonensis Schäffler, Frankenbach & Dufek, 2011
8. M. cypris ceibaensis Schäffler, Frankenbach & Dufek, 2011
Sous-genre Morpho Fabricius, 1807 (in part)
(= Pessonia Le Moult & Réal, 1962)
Morpho (Morpho) achilles (Linnaeus, 1758)
1. M. achilles achilles (Linnaeus, 1758)
2. M. achilles patroclus C. Felder & R. Felder, 1861
3. M. achilles vitrea Butler, 1866
4. M. achilles agamedes Fruhstorfer, 1912
5. M. achilles phokylides Fruhstorfer, 1912
6. M. achilles guaraunos Le Moult, 1925
7. M. achilles aguiro Le Moult, 1933
8. M. achilles songo Weber, 1944
9. M. achilles ella Weber, 1944
10. M. achilles glaisi Le Moult & Réal, 1962
11. M. achilles fagardi Weber, 1963
Morpho (Morpho) helenor (Cramer, 1776)
1. M. helenor helenor (Cramer, 1775)
2. M. helenor achillaena (Hübner [1823])
3. M. helenor peleides Kollar, 1850
4. M. helenor corydon Guenée, 1859
5. M. helenor montezuma Guenée, 1859
6. M. helenor octavia Bates, 1864
7. M. helenor coelestis Butler, 1866
8. M. helenor achillides C. Felder & R. Felder, 1867
9. M. helenor leontius C. Felder & R. Felder, 1867
10. M. helenor marinita Butler, 1872
11. M. helenor limpida Butler, 1872
12. M. helenor papirius Hopffer, 1874
13. M. helenor narcissus Staudinger, 1887
14. M. helenor bahiana Fruhstorfer, 1897
15. M. helenor maculata Röber, 1903
16. M. helenor telamon Röber, 1903
17. M. helenor peleus Röber, 1903
18. M. helenor theodorus Fruhstorfer, 1907
19. M. helenor rugitaeniatus Fruhstorfer, 1907
20. M. helenor anakreon Fruhstorfer, 1910
21. M. helenor violaceus Fruhstorfer, 1912
22. M. helenor insularis Fruhstorfer, 1913
23. M. helenor macrophthalmus Fruhstorfer, 1913
24. M. helenor tucupita Le Moult, 1925
25. M. helenor extremus Le Moult, 1933
26. M. helenor faustina Rousseau-Decelle, 1935
27. M. helenor tepuina Forbes, 1942
28. M. helenor taboga Le Moult & Réal, 1962
29. M. helenor guerrerensis Le Moult & Réal, 1962
30. M. helenor carillensis Le Moult & Réal, 1962
31. M. helenor veragua Le Moult & Réal, 1962
32. M. helenor charapensis Le Moult & Réal, 1962
33. M. helenor ululina Le Moult & Réal, 1962
34. M. helenor minensis Le Moult & Réal, 1962
35. M. helenor popillina Le Moult et Réal, 1962
36. M. helenor uberabensis Le Moult & Réal, 1962
37. M. helenor marajoensis Le Moult & Réal, 1962
38. M. helenor lacommei Blandin, 2007
39. M. helenor mielkei Blandin, 2007
40. M. helenor courtini Blandin, 2007
41. M. helenor bristowi Blandin, 2007
42. M. helenor cormieri Blandin, 2007
43. M. helenor guanacastensis Blandin, 2007
44. M. helenor packeri Neild, 2008
45. M. helenor dufeki Schäffler & Frankenbach, 2008
46. M. helenor caldarai Schäffler & Frankenbach, 2011
47. M. helenor coibaensis Jongerling, 2011
48. M. helenor prometa Gareca & Blandin, 2011
Morpho (Morpho) epistrophus (Fabricius, 1796)
1. M. epistrophus epistrophus (Fabricius, 1796)
2. M. epistrophus catenaria (Perry, 1811)
3. M. epistrophus argentinus Fruhstorfer, 1907
4. M. epistrophus nikolajewna Weber, 1951
Morpho (Morpho) deidamia (Hübner, [1819])
1. M. deidamia deidamia (Hübner, [1819])
2. M. deidamia neoptolemus Wood, 1863
3. M. deidamia pyrrhus Staudinger, 1887
4. M. deidamia hermione Röber, 1903
5. M. deidamia electra Röber, 1903
6. M. deidamia guaraura Le Cerf, 1925
7. M. deidamia grambergi Weber, 1944
8. M. deidamia diomedes Weber, 1944
9. M. deidamia diffusa Le Moult & Réal, 1962
10. M. deidamia steinbachi Le Moult & Réal, 1962
11. M. deidamia annae Duchêne & Blandin, 2004
12. M. deidamia mariae Blandin, 2007
13. M. deidamia jacki Neild, 2008
Morpho (Morpho) polyphemus Westwood , [1850]
1. M. polyphemus polyphemus Westwood, [1850]
2. M. polyphemus luna Butler, 1869
3. Morpho polyphemus catalina Corea & Chacón, 1984
Morpho (Morpho) iphitus C. Felder & R. Felder, 1867
1. M. iphitus iphitus C. & R. Felder, 1867
2. M. iphitus titei Le Moult & Réal, 1962
Morpho (Morpho) granadensis C. Felder & R. Felder, 1867
1. M. granadensis granadensis C. Felder & R. Felder, 1867
2. M. granadensis polybaptus Butler, 1875
3. M. granadensis lycanor Fruhstorfer, 1907
Sous-genre Grasseia Le Moult & Réal, 1962
Morpho (Grasseia) menelaus (Linnaeus, 1758)
1. M. menelaus menelaus (Linnaeus, 1758)
2. M. menelaus coeruleus (Perry, 1810)
3. M. menelaus occidentalis C. Felder & R. Felder, 1862
4. M. menelaus terrestris Butler, 1866
5. M. menelaus melacheilus (Staudinger, [1886])
6. M. menelaus mineiro Fruhstorfer, 1907
7. M. menelaus ornata Fruhstorfer, 1913
8. M. menelaus orinocensis Le Moult, 1925
9. M. menelaus verae Weber, 1951
0. M. menelaus kesselringi Fischer, 1962
11. M. menelaus eberti Fischer, 1962
12. M. menelaus offenbachi Bryk, 1953
13. M. menelaus zischkai Fischer, 1962
14. M. menelaus pucallpensis Blandin, 2007
15. M. menelaus lecromi Blandin, 2007
16. M. menelaus laurellae Neild, 2008
17. M. menelaus neildi Blandin, 2008
Morpho (Grasseia) godartii Guérin – Méneville, [1844]
1. M. godartii godartii Guérin – Méneville, [1844]
2. M. godartii alexandra Hewitson, 1863
3. M. godartii didius Hopffer, 1874
4. M. godartii assarpai Röber, 1903
5. M. godartii julanthiscus Fruhstorfer, 1907
6. M. godartii lachaumei Blandin, 2007
7. M. godartii tingomariensis Blandin, 2007
8. M. godartii titogilberti Blandin & Gareca, 2011
Morpho (Grasseia) amathonte Deyrolle, 1860
1. M. amathonte amathonte Deyrolle, 1860
3. M. amathonte centralis Staudinger, 1887
2. M. amathonte sarareus Le Cerf, 1926
4. M. amathonte ecuadorensis Le Moult & Réal, 1962
5. M. amathonte canyarensis Nakahara & Blandin, 2010
Sous-genre Cytheritis Le Moult & Réal, 1962
(= Balachowskyna Le Moult & Réal, 1962)
Morpho (Cytheritis) portis (Hübner, [1821])
1. M. portis portis (Hübner, [1821])
2. M. portis thamyris C. Felder & R. Felder, 1867
3. M. portis kaysi Le Moult & Réal, 1962
Morpho (Cytheritis) aega (Hübner, [1822])
Morpho (Cytheritis) sulkowskyi Kollar, 1850
1. M. sulkowskyi sulkowskyi Kollar, 1850
2. M. sulkowskyi hoppiana Niepelt, 1923
3. M. sulkowskyi nieva Lamas & Blandin, 2007
Morpho (Cytheritis) aurora Westwood, 1851
1. M. aurora aurora Westwood, 1851
2. M. aurora aureola Fruhstorfer, 1913
3. M. aurora breyeri Orfila, 1963
4. M. aurora isidorssoni Blandin, 2006
5. M. aurora lamasi Blandin, 2006
Morpho (Cytheritis) lympharis Butler, 1873
1. M. lympharis lympharis Butler, 1873
2. M. lympharis eros Staudinger, 1892
3. M. lympharis selenaris Le Moult & Réal, 1962
4. M. lympharis stoffeli Le Moult & Réal, 1962
5. M. lympharis descimokoenigi Blandin, 1993
6. M. lympharis calderoni Blandin & Lamas, 2007
7. M. lympharis achiras Fisher, 2009
8. M. lympharis zachi Schäffler & Frankenbach, 2009
Morpho (Cytheritis) zephyritis Butler, 1873
1. M. zephyritis zephyritis Butler, 1873
2. M. zephyritis cesarsamensis Blandin, 2007
Morpho (Cytheritis) rhodopteron Godman & Salvin, 1880
1. M. rhodopteron rhodopteron Godman & Salvin, 1880
2. M. rhodopteron nevadensis E. Krüger, 1925
Morpho (Cytheritis) absoloni May, 1924
Le genre Morpho et la sous-famille des Morphinae (Nymphalidae)

1. MORPHO ET AUTRES MORPHINAE, PAPILLONS DU NOUVEAU MONDE
[dropcap]L[/dropcap]es papillons du genre Morpho sont emblématiques de l’Amazonie. Les belles espèces d’un bleu brillant sont connues du grand public, car elles sont souvent présentées dans des cadres décoratifs vendus comme souvenirs, par exemple en Guyane, et certaines sont représentées dans des documents de promotion touristiques. Le genre Morpho appartient à une sous-famille des Nymphalidae, les Morphinae, qui n’existe qu’en Amérique tropicale, du nord de l’Argentine au nord du Mexique. Cette sous-famille comprend aussi la tribu des Brassolini, un groupe très varié dont les représentants les plus connus, souvent mis dans des cadres décoratifs, sont les Caligo. Présentés à l’envers et tête en bas, ces gros papillons dont la face inférieure sont décorées de grands « yeux » évoquent une tête de rapace nocturne, ce pourquoi on leur donne souvent le nom de « papillon-chouette ». Volant à l’aube et au crépuscule, ils sont difficiles à voir. Mais dans la journée, ils sont posés sur des troncs ou des feuilles : lorsque l’on se déplace, on en dérange de temps à autre. Les Morphinae incluent aussi de curieux cousins des morphos, aussi discrets que les morphos sont visibles: les Antirrhea et les Caerois volent dans la pénombre des sous-bois, se posant sur la litière où ils se confondent totalement avec leurs ailes couleur de feuille morte.
Beaucoup de morphos, à la fois parce qu’ils sont spectaculaires et rares, sont très recherchés par les collectionneurs, depuis le XIXe siècle. Déjà, certains spécimens existaient dans des cabinets d’histoire naturelle au XVIIIe siècle. En 1758, le grand naturaliste suédois Linné décrivit 3 espèces, auxquelles il donna des noms de grands personnages de la mythologie : achilles, menelaus et telemachus. Avant 1800, 8 espèces étaient décrites, provenant du Surinam ou du sud-est du Brésil. De 1800 à 1824, 5 autres espèces furent décrites, une du Surinam, les autres à nouveau du sud-est brésilien.
Pendant 25 ans, aucune nouvelle espèce de morpho ne fut découverte, sauf un premier morpho andin, Morpho godartii, de Bolivie, décrit en 1844. La période 1850-1874 fut beaucoup plus riche en découvertes: 11 espèces au total, de Guyane, du bassin amazonien, du Pérou, de Colombie, du Mexique et encore du sud-est du Brésil. Le français Emile Deyrolle, dont l’entreprise existe toujours rue du Bac à Paris, décrivit en 1860 deux espèces de Colombie et le fameux Morpho eugenia de Guyane, qui resta longtemps mystérieux, jusqu’à ce que l’on découvre que les mâles ne volent qu’une vingtaine de minutes vers 6 h du matin !
A l’orée du XXe siècle, 27 taxons que je considère aujourd’hui comme des espèces étaient décrits, sans compter d’assez nombreuses formes aujourd’hui classées comme sous-espèces ou simples formes individuelles. En 1912-1913, une première synthèse sur l’ensemble du genre Morpho fut publiée par Henri Fruhstorfer dans le monumental ouvrage « Die Schmetterlinge der Erde », publié sous le direction d’Adalbert Seitz.
Ensuite, deux dernières espèces valables furent découvertes, l’une en 1924, l’autre en 1927.
En 1962, les français Eugène Le Moult et Pierre Réal publièrent une étude très complète, « Les Morpho d’Amérique du Sud et Centrale », suivie en 1963 par un volume de planches. Ce travail a apporté de réelles avancées dans la connaissance des morphos, mais il a aussi créé de graves confusions, et il a encombré la systématique en nommant quantité de sous-espèces, de formes saisonnières et de formes individuelles, scientifiquement injustifiées. Difficile à lire, du fait d’une rédaction complexe, pour les non francophones, le livre de Le Moult et Réal a pratiquement bloqué toute recherche sérieuse sur le genre Morpho, en rendant très difficile la détermination exacte de nombreuses formes.
Ayant commencé à publier sur les morphos à partir de 1968, j’ai été sollicité au début des années 80 pour écrire une étude d’ensemble du genre, afin de le remettre en ordre. Ce travail, « The Genus Morpho », a été publié en anglais, en trois parties, parues en 1988, 1993 et 2007. Conçu pour le public des amateurs, cet ouvrage constitue une mise à jour de la systématique, qui a été grandement simplifiée ; toutes les espèces et presque toutes les sous-espèces y sont représentées grandeur nature et en couleur. Le texte apporte les informations essentielles, mais ne développe pas toute l’analyse scientifique et historique qui a permis la mise en ordre de la systématique. Celle-ci a été publiée séparément, pour les spécialistes, en 2007, sous le titre « The Systematics of the Genus Morpho ».
Mes recherches se sont appuyées pour partie sur la collection du Muséum National d’Histoire Naturelle, ainsi que les collections de muséums étrangers, en particulier le Natural History Museum, à Londres, sans compter des collections privées françaises. Un réseau de collègues étrangers, professionnels et amateurs, m’a en outre permis d’obtenir des informations précises, des photographies de très nombreux spécimens de collections publiques et privées, du Venezuela et de Colombie. J’ai en outre bénéficié de l’aide du Docteur Gerardo Lamas, Chef du département d’entomologie du Muséum d’Histoire Naturelle de Lima (Universidad Mayor de San Marcos), spécialiste de renommée mondiale des Lépidoptères d’Amérique du Sud.
Mes ouvrages constituent désormais la référence mondiale pour tous les amateurs et professionnels travaillant sur les morphos. Ils présentent l’état des connaissances en 2007. La recherche continue, et de nouvelles sous-espèces ont été décrites depuis. Les chercheurs disposent maintenant d’une base solide pour étudier la répartition géographique, l’écologie et l’évolution des morphos. J’ai ainsi participé à la direction de la thèse de Catherine Cassildé, soutenue en 2009, consacrée à la phylogénie du genre Morpho, étudiée à l’aide de caractères morphologiques et moléculaires.
- Publication associées
Téléchargez les publications associées en bas de page.


2. RECHERCHES DANS LE NORD DU PEROU
A partir de 2005, avec la collaboration bénévole de Gilbert Lachaume, j’ai mis en œuvre un programme de recherche sur les Lépidoptères diurnes du nord du Pérou, région très insuffisamment explorée, mais que les informations disponibles désignaient comme une région importante du point de vue faunistique et biogéographique. La région choisie est située essentiellement dans les Départements San Martín, Amazonas et Cajamarca.
Les recherches portent pour l’essentiel sur la sous-famille des Morphinae. L’objectif général est de caractériser la diversité, la répartition géographique et les patrons d’évolution de ces Lépidoptères dans un complexe de vallées divergentes et de cordillères fragmentées, au sein du « Hotspot de biodiversité des Andes Tropicales ».
Le projet a été initialement soutenu par le Programme « Etat et structure phylogénétique de la biodiversité actuelle et fossile » du Muséum National d’Histoire Naturelle. Il est mené en collaboration avec le Dr. Gerardo Lamas, chef du département d’entomologie du Muséum de Lima, et fait l’objet de permis de collecte et d’exportation de spécimens délivrés par l’autorité péruvienne compétente.
A la suite des dernières missions, en mars et en novembre 2009, l’inventaire des Morpho et des Brassolini est pratiquement achevé pour le bassin du río Huallaga. La comparaison des résultats avec toutes les données dont je dispose sur l’ensemble des Andes tropicales montre que la région étudiée apparaît comme la plus riche de tout le Hotspot des Andes Tropicales.
Les données qui étaient disponibles avant ce programme montraient que la faune de forêt de plaine (« selva baja ») du haut río Huallaga, dans la région de Tingo María (presque 500 km au sud du débouché du fleuve dans la plaine amazonienne) diffèrent notablement de celle de la plaine amazonienne : quelques espèces manquantes et d’autres sont représentée par des sous-espèces différentes. Nous avons mis en évidence une large zone de transition entre les deux faunes, entre la région de Tarapoto, au nord et celle de Juanjuí, cent kilomètres plus au sud : chez certaines espèces, les populations présentent des caractéristiques intermédiaires entre sous-espèce amazonienne et sous-espèce de la haute vallée. Ce phénomène s’observe chez plusieurs espèces de Morpho et de Brassolini.
Nous étudions par ailleurs la répartition altitudinale des espèces, depuis la « selva baja » (200-600 m) jusqu’à la « selva de neblina » (1900-2500 m). En particulier, nous explorons les relations entre deux espèces très voisines, l’une de forêt amazonienne, Morpho menelaus, l’autre de forêt de montagne, Morpho godartii : nous avons découvert une population dont les individus présentent des caractères hybrides. Dans la selva de neblina, nous étudions les relations géographiques entre les sous-espèces de Morpho sulkowskyi que j’ai décrites de la région avec Gerardo Lamas. Ces travaux impliquent des études fines, à l’échelle de populations bien localisées ; les spécimens récoltés sont comparés d’un point de vue morphologique et d’un point de vue moléculaire ; grâce à une collaboration avec Jean-François Silvain et Claire Capdevielle, du Laboratoire Evolution, Génome, Spéciation (CNRS, Gif-sur-Yvette), nous comparons les séquences de certains gènes pour préciser les relations phylogénétiques entre espèces et sous-espèces.
Ces recherches m’ont conduit à participer au projet international Tropical Andean Butterflies Diversity (TABD). En 2008, j’ai été invité à un atelier ayant pour but de préparer un ouvrage de synthèse et de définir des objectifs pour les années à venir (atelier « Prioridades para la investigación y la conservación de las mariposas andinas tropicales », Urubamba, Pérou, 1-3 septembre 2008). L’atelier se poursuivait par un symposium réunissant des participants, dont beaucoup d’étudiants, de tous les pays concernés (« Primera Conferencia Internacional en las Mariposas Andinas », 120 participants, Urubamba, 4-6 septembre 2008). J’y ai présenté une communication intitulée : « El Genero Morpho Fabricius, 1807 : Historía, Diversidad, Conservación ». Grâce au réseau TABD, j’ai pu offrir « The Systematics of the Genus Morpho » à une trentaine de chercheurs ou étudiants d’Amérique Latine. Avec Gilbert Lachaume, j’ai écrit un article retraçant la découverte des Morpho dans le nord du Pérou, replaçant ainsi nos recherches dans une histoire longue de plus d’un siècle, une façon de rendre hommage à des pionniers qui, dans des conditions autrement difficiles qu’aujourd’hui, avaient fait dès le début du XXe siècle des observations fondamentales et avaient pressenti des questions d’évolution qui attendent encore des réponses.
L’un des objectifs principaux du projet TABD est la définition d’aires de conservation. Mon étude des Morpho du nord du Pérou montre que cette région constitue un « point hyper-chaud » du hotspot des Andes tropicales. A la réunion d’Urubamba, j’ai insisté sur le fait que la délimitation d’aires à protéger ne pouvait constituer à elle seule une stratégie de conservation efficace. Une grande partie des problèmes se pose en effet dans des zones déjà fortement modifiées par l’agriculture : comme dans nos pays occidentaux, la question est aussi celle du maintien de la biodiversité ordinaire, dont plusieurs espèces de Morpho, encore communes dans de nombreux endroits, sont probablement de bons indicateurs.
3. LES MORPHINAE DE BOLIVIE
A la fin du 19e siècle et au début du 20e, des voyageurs naturalistes, Otto Garlepp puis Anton H. Fassl collectèrent en Bolivie, essentiellement dans le département de La Paz. On trouve de leurs spécimens en particulier dans divers muséums. Pendant les deux premières décennies du 20e siècle, le naturaliste José (Joseph) Steinbach, basé à Buena Vista, dans le département de Santa Cruz, fournissait de nombreux muséums en spécimens d’histoire naturelle, notamment en insectes. Plus tard, l’un de ses fils, Francisco (Franz) Steinbach, reprit cette activité, en collectant dans la région de Buenavista et dans le Chapare (département Cochabamba).
A la fin des années 1960, je recevais des spécimens envoyés par Franz Steinbach à Henri Descimon. C’est ainsi que l’une de mes toutes premières publications sur les Morphos fut consacrée à l’espèce Morpho godartii, décrite en 1840, un grand Morpho aux nuances mauves et nacrées, emblématique de la Bolivie. La systématique en avait été rendue particulièrement confuse par Le Moult et Réal dans le livre Les Morpho d’Amérique du Sud et Centrale (1962, 1963). Ces auteurs avaient décrit des formes saisonnières et des formes altitudes à partir de spécimens de collection sans date ni altitude de capture ! D’après le matériel dont je disposais, il était évident qu’il s’agissait de variations individuelles (publication n°5).
A l’époque, je ne connaissais que des spécimens provenant des environs de Buena Vista (département Santa Cruz) et de localités du département voisin de Cochabamba. Des années plus tard, Gilbert Lachaume commença à collecter dans le haut bassin du río Beni, dans la région autrefois parcourue par Otto Garlepp et Anton H. Fassl. Il travailla notamment près de Caranavi (département La Paz). Lorsque j’entrepris la révision de Morpho godartii, dans le cadre de la préparation de la 3e partie de The Genus Morpho, il m’apparu évident que les populations échantillonnées par Gilbert Lachaume différaient de celles connues jusqu’alors, et je les ai décrites en 2007 sous le nom de Morpho godartii lachaumei.
En 1984, Gilbert Lachaume, le long d’une route traversant les Andes plus sèches du sud du Pérou, avait attrappé un mâle de M. godartii qui volait avec une femelle, mais il avait manqué celle-ci. Ce mâle, d’une couleur bleue intense inhabituelle, a été représenté dans The Genus Morpho, 3e partie, mais je n’avais pas osé lui donner un nom de sous-espèce, faute d’un échantillon suffisant. Or, depuis quelques années, j’ai engagé une collaboration avec Yuvinka Gareca, entomologiste attachée au Museo de Historia Natural Alcide d’Orbigny à Cochabamba, pour l’aider à étudier les Morphinae boliviens. Yuvinka Gareca et d’autres entomologistes boliviens, surtout Tito Vidaurre, ont constitué des échantillons importants, comprenant des femelles, de la forme découverte par Gilbert Lachaume. Il s’agit de populations inféodées aux forêts semi-décidues des Yungas del Sur. L’originalité de ces populations a été ainsi confirmée, et nous avons décrit en setembre 2011 la nouvelle sous-espèce sous le nom Morpho godartii titogilberti, en l’honneur de ses deux principaux découvreurs (Publication n° 233).
Nous avons par ailleurs fait une mise au point sur la répartition de l’espèce la plus commune, Morpho helenor, dont une nouvelle sous-espèce a été découverte, notamment par Yuvinka Gareca, dans ces mêmes forêts semi-décidues, qui s’étendent dans le sud du pays jusque vers l’Argentine. Grâce à l’étude des nombreux spécimens conservés dans les collections boliviennes, en particulier au Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, à Santa Cruz, nous avons pu préciser la distribution géographique des trois sous-espèces de M. helenor désormais connues en Bolivie. Un article est paru dans la revue Zootaxa, sous le titre: « Morpho (Morpho) helenor (Cramer) (Lepidoptera, Nymphalidae, Morphinae) in Bolivia: geographical distribution and ecological plasticity, with a description of a new subspecies ».(Publication 237)
Ces découvertes, dans un genre supposé bien connu, montrent qu’il y a encore beaucoup de recherches à mener pour connaître la biodiversité d’un pays aussi vaste et aussi varié d’un point de vue écologique que la Bolivie.
4. GESTION DE LA PLUS GRANDE COLLECTION PUBLIQUE MONDIALE DE MORPHINAE
Les collections de Lépidoptères du Muséum National d’Histoire Naturelle sont depuis 2014 en réorganisation. Les locaux sont en cours de rénovation et progressivement équipés de nouvelles armoires, où les spécimens sont rangés dans des boîtes neuves. J’assure, en appui aux personnels du Muséum, la réorganisation de l’ensemble des Morphinae.
La collection « ancienne » (antérieure aux années 1990) comprend plus de 2000 Morphinae. De nombreux spécimens proviennent de collections datant de la fin du 19e et du début du 20e siècle. On trouve quelques spécimens de Morpho plus anciens, tel un Morpho anaxibia de 1850, vraisemblablement de la région de Rio de Janeiro. Incorporée en 1892, la collection de Beaulieu a apporté notamment quelques Morpho du bassin amazonien, vraisemblablement collectés par le Français Marc Hüe de Mathan. Au tout début du 20e siècle, un mécène, Eugène Boullet, a enrichi considérablement la collection, acquérant des spécimens du monde entier, et payant du personnel pour les préparer. C’est ainsi qu’il acquit, pour 500 F de l’époque (vers 1905) une femelle alors rarissime d’une sous-espèce péruvienne de Morpho rhetenor. Il se procurait les spécimens notamment auprès de la firme allemande Staudinger & Bang-Haas, qui les recevait en particulier des naturalistes-voyageurs Otto et Gustav Garlepp, Otto Michael et Anton Heinrich Fassl. Dans les années 1920-1930, des spécimens provenant principalement de Guyane Française étaient fournis par Eugène Le Moult et par Lucien Séraphin, deux négociants en entomologie. A la collection générale s’ajoute la collection de Morpho de Madame Fournier, qui comprend environ un millier de spécimens réunis pendant la première moitié du 20e siècle.
En 1997, le mathématicien Laurent Schwartz avait fait don de sa collection de Morpho, soit sans doute de l’ordre de 1500 spécimens, qui ont été remis au Muséum en 2002. En 1997 également, j’ai donné ma collection de Morphinae, qui comprenait alors près de 4000 spécimens, dont près de 1800 Morpho, et je continue de l’enrichir ; elle compte aujourd’hui plus de 5000 spécimens (dont la moitié du genre Morpho). Depuis, le Muséum a reçu d’autres dons, en particulier, en 2008, la collection Jacques Dubois qui contient plusieurs centaines de Morphinae. A mon initiative, une sélection de Morpho de la collection Bernard Courtin a été acquise en 2007, des Morpho et Brassolini ont été préemptés à des ventes aux enchères en 2007 et 2008, et en 2011 une sélection de Morpho de la collection Gérard Duchêne a été acquise avec l’aide de la Société des Amis du Muséum, soit en tout plus de 500 spécimens. En 2007, le Professeur Janzen (Philadelphie) m’a remis pour le Muséum un ensemble représentatif des Morphinae du nord-ouest du Costa Rica ; en 2010, le Dr Pyrcz (Cracovie) a de même donné quelques Morpho collectés par lui au Venezuela, dans des zones rarement prospectées, et en 2014 l’entomologiste vénézuélien Mauro Costa a offert un échantillon représentatif des Opsiphanes (Brassolini= de son pays ; soit au total plus de 100 spécimens. Par ailleurs, les missions effectuées depuis 2005 dans le nord du Pérou ont permis de rapporter un important échantillonnage de Morphinae, dont une partie (près de 1300 spécimens) a été à ce jour (juin 2015) incorporée à la collection. Le dénombrement de l’ensemble de la collection est encore approximatif, dans l’attente de son rangement définitif : le nombre total de spécimens dépassera vraisemblablement 12000, dont probablement plus de 7000 Morpho.
Hormis ceux de la collection Fournier, qui forme un ensemble historique intangible, tous les spécimens sont progressivement organisés en une seule collection. Le travail a débuté en 2014, et se poursuivra au long de 2015 en ce qui concerne l’arrangement des spécimens dans les boîtes. Suivra la mise à jour des déterminations.
5. PUBLICATIONS
1. La mise en ordre du genre Morpho
91. BLANDIN, P., 1988. The genus Morpho. Part. 1. The sub-generaIphimedeia and Schwartzia. Editions Sciences Nat., Venette: 42 p. 6cartes, 20 planches.
125. BLANDIN, P., 1993. The Genus Morpho. Part 2. The SubgeneraIphixibia, Cytheritis, Balachowskyna and Cypritis. Editions SciencesNat, Venette: 56p., 8 cartes, 16 planches.
198. BLANDIN, P., 2007. The Systematics of the Genus Morpho Fabricius, 1807. Hillside Books, Canterbury: 277 p.
199. BLANDIN, P., 2007. The Genus Morpho, Lepidoptera Nymphalidae, Part3. Addenda to Part 1 and Part 2 & The Subgenera Pessonia, Grasseia,and Morpho. Hillside Books, Canterbury: I-XI, 99-237.
2. Autres publications sur le genre Morpho
2. BLANDIN, P., 1968. Un nouvel exemplaire femelle de Morpho helena Staudinger (Nymphalidae). Alexanor, 5 : 319-325.
3. BLANDIN, P., 1968. Remarques complémentaires sur les femelles de Morpho helena et Morpho cacica (Nymphalidae). Alexanor, 5 : 343-344.
5. BLANDIN, P., 1970.- Remarques sur les variations de Morpho (Grasseia) godarti Guérin (Nymphalidae). Alexanor, 6 : 275-280, 321-326.
7. BLANDIN, P., et DESCIMON, H., 1970. Contribution à la connaissance des Lépidoptères de l’Equateur. Le genre Morpho (Nymphalidae). Alexanor, 6 : 371-380.
19. BLANDIN, P., et JEANNOT, G., 1974. Polytypisme et polymorphisme chez Morpho telemachus Linné, 1758 (Lepidoptera, Nymphalidae). Arch. Zool.exp. gén., 115 (2) : 229-249
BLANDIN, P., 1977. Note sur Morpho (Iphimedeia) hecuba polyxena Biedermann, 1936, avec la description de la femelle (Lep.-Nymphalidae). Bull. Soc. ent. Fr., 82 : 198-200. (bl 41)
171. BLANDIN, P. 2003. Liste des Morphinae de Guyane. In : LACOMME, D.& MANIL, L. (éds.), Lépidoptères de Guyane. Bulletin des Lépidoptéristes Parisiens, Hors-série, 2003 : 26.
181. DUCHENE, G. & BLANDIN, P., 2004. Etude de Morpho deidamia (Hübner [1819]) dans la région des Guyanes, avec la description de M. deidamia annae nov. ssp. de la Guyana (Lepidoptera, Nymphalidae,Morphinae). Lépidoptères, 2 (1): 1-19.
193. BLANDIN, P., 2006. Deux nouvelles sous-espèces péruviennes de Morpho (Balachowskyna) aurora Westwood, 1851 (Lepidoptera, Nymphalidae). Bulletin de la Société entomologique de France, 111 (3) : 321-325.
201. BLANDIN, P., 2007. Laurschwartzia nom. nov., nom de substitution pour le sous-genre Schwartzia Blandin, 1988 (Lep., Nymphalidae, Morphinae). Bulletin de la Société entomologique de France, 112 (4) :510.
203. BLANDIN, P., 2008. Une nouvelle sous-espèce péruvienne de Morpho rhetenor (Cramer, 1775) (Lepidoptera, Nymphalidae). Bulletin de la Société entomologique de France, 113 (2) : 187-196.
204. BLANDIN, P., 2008. Las mariposas azules del Alto Mayo : el género Morpho Fabricius, 1807 (Lepidoptera : Nymphalidae, Morphinae). In: INRENA, Plan Maestro del Bosque de Protección Alto Mayo 2008-2013. Lima: 247-250.
207. BLANDIN, P., 2008.- Morpho menelaus neildi Blandin ssp. nov. In :NEILD, A. F. E., The Butterflies of Venezuela. Part 2: Nymphalidae II( Acraeinae, Libytheinae, Nymphalinae, Ithomiinae, Morphinae). Meridian Publications, London: 220, 239, figs. 1325, 1326, 1329, 1330, 1333,1334.
217. DUCHÊNE, G. & BLANDIN, P., 2009. Les sous-espèces de Morpho (Iphimedeia) amphitryon Staudinger, 1887 en Bolivie et dans le sud du Pérou, et leurs rapports avec les sous-espèces de Morpho (Iphimedia) telemachus (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera : Nymphalidae, Morphinae). Bulletin de la Société entomologique de France. 114(3) : 373-382.
237. GARECA, Y. & BLANDIN, P., 2011. Morpho (Morpho) helenor (Cramer) (Lepidoptera, Nymphalidae, Morphinae) in Bolivia : Geographical distribution and ecological plasticity, with a description of a new subspecies. Zootaxa 31130: 30-56.
240. CASSILDE, C., BLANDIN, P. & SILVAIN, J.F., 2012. Phylogeny of the genus Morpho Fabricius, 1807: insights from two mitochondrial genes (Lepidoptera: Nymphalidae). Annales de la Société entomologique de France, 48(1-2): 173-188.
3. Publications sur les Brassolini
20. BLANDIN, P., et DESCIMON, H., 1975.- Contribution à la connaissance des Lépidoptères de l’Equateur. Les Brassolinae (Nymphalidae). Ann.Soc. ent. Fr. (N.S.), 11 (1) : 3-28.
30. BLANDIN, P., et DESCIMON, H., 1977.- Contribution à la connaissance des Lépidoptères de l’Equateur. Nouvelles données sur les Brassolinae (Nymphalidae) de l’Occidente. Ann. Soc. ent. Fr. (N.S.), 13 (1) : 75-88.
47. BLANDIN, P., 1978.- Contribution à la biogéographique néotropicale : espèces endémiques, espèces polytypiques et super-espèces chez les Brassolinae (Lepidoptera- Satyridae). C.R. Soc. Biogéogr., 471 : 9-28.
172. BLANDIN, P., 2003.- Quelques données sur les Brassolinae de Guyane française (Lepidoptera, Nymphalidae). In : Lacomme, D. & Manil, L.(éds.), Lépidoptères de Guyane. Bulletin des Lépidoptéristes Parisiens, Hors-série, 2003 : 33-38.
246. CHACON, I.A., MONTERO-RAMIREZ, J., JANZEN, D.H., HALLWACHS, W., BLANDIN, P., BRISTOW, C.R. & HAJIBABAEI, M., 2012. A new species of Opsiphanes Doubleday, [1849] from Costa Rica (Nymphalidae: Morphinae: Morphini), as revealed by its DNA barcodes and habitus. Bulletin of the Allyn Museum, 166: 1-15.
- Téléchargements
Cliquez sur les liens en bleu pour télécharger les publications.
La Forêt de Fontainebleau… et autres lieux boisés du bassin parisien

Premiers pas en forêt, pour cause d’araignées
[dropcap]E[/dropcap]n 1969, je commençais ma thèse sur les Araignées de la savane de Lamto, et j’encadrais un étudiant du DEA d’Entomologie d’Orsay, Thierry Christophe : son stage visait à étudier la démographie d’une espèce de Lycose bien représentée dans les échantillons de Lamto. Thierry Christophe souhaita ensuite faire une thèse de 3e Cycle, mais il parut difficile de poursuivre la recherche engagée pour son DEA. Nous décidâmes de travailler en région parisienne. Un collègue, Charles Lecordier, nous incita à étudier les araignées de la litière en forêt de Montmorency, dans le nord de Paris, où il menait des recherches dans un domaine clos géré par l’Office National des Forêts. A partir de 1971, tous les 15 jours pendant un peu plus d’un an, nous avons récolté à la main les araignées présentes dans la litière, à l’intérieur de carrés de 50 x 50 cm. Nous n’avons pas oublié certains jours d’hiver, où la récolte se faisait en fouillant la litière gelée… Inventaire des espèces, variation saisonnières du peuplement, étude démographique d’une espèce par combinaison des résultats des échantillonnages et d’un élevage, tel fut le contenu de la thèse de Thierry Christophe, qu’il soutint en 1974. Ce fut ma première expérience de direction de thèse, et mes premiers pas en écologie forestière (Publication 40).
L’organisation de la Station Biologique de Foljuif et les recherches en écologie forestière
En 1966, l’ENS avait accepté la donation, proposée en 1964, d’un domaine situé sur la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours, comprenant le château de Foljuif, des communs, un vaste parc et quelques dizaines d’hectares de forêt et de terres cultivées, dans le bois de la Commanderie, prolongement sud de la forêt de Fontainebleau. Le Professeur Maxime Lamotte, directeur du Laboratoire de Zoologie, avait poussé la Direction de l’ENS à accepter cette donation, en particulier pour organiser des stages de terrain pour les élèves naturalistes de l’ENS. Des employés de l’ENS, M. et Mme Loyau, furent logés sur place fin 1967, et le premier stage eut lieu au printemps 1968, dans des locaux sommairement aménagés, avec lits superposés et tables de travail installés dans un bâtiment des communs, « le pigeonnier ». Dès 1969, des stages furent aussi organisés pour le 3e cycle d’écologie de l’Université de Paris. En 1970, un grenier fut transformé en salle de cours et de travaux pratiques. Au fil des années, d’autres locaux furent aménagés, tant pour les activités de recherche et d’enseignement que pour l’hébergement des étudiants. Par ailleurs, après quelques échanges de parcelles de forêt avec des voisins, un ensemble d’environ 10 ha fut clôturé début 1976, afin de servir de terrain d’étude.
J’organisais des stages en particulier pour le 3e cycle d’écologie de l’Université Pierre et Marie Curie (auquel je participais comme Maître-Assistant depuis octobre 1973) et, à partir de 1976, pour le Cours Post Universitaire « Étude et aménagement des milieux naturels » de la Commission nationale française pour l’UNESCO (où j’avais pris la suite du Professeur Lamotte en 1974).
Le domaine fut appelé « Station Biologique de Foljuif ». La Direction de l’ENS m’en confia la responsabilité à partir de 1975, pour y développer des recherches d’écologie forestière et des stages de terrain. Le contexte était délicat, car la donation était contestée par un héritier du donateur. Une procédure avait été engagée en mai 1975, et il fallut presque 4 ans pour qu’une solution amiable soit finalement trouvée. L’ENS devait montrer qu’elle entretenait les lieux et valorisait le domaine scientifiquement et pédagogiquement. En mai 1975, j’élaborais un programme de recherche, intitulé « Etude structurale et fonctionnelle d’un écosystème forestier en zone suburbaine », qui permit d’obtenir des crédits du ministère de l’enseignement supérieur. En dehors de quelques travaux d’ornithologie commencés en 1972, l’essentiel des recherches fut consacré à l’écologie de la faune du sol, dans le cadre de stages de DEA et de thèses de 3e cycle d’écologie. Une première thèse démarra à l’automne (recherches de Jean-Jacques Geoffroy sur les Myriapodes du sol), et 7 autres suivirent, jusqu’en 1983.
Avec les stagiaires et doctorants du 3e cycle d’écologie, j’ai ainsi constitué une petite équipe d’écologie forestière, qui fut officialisée comme composante du Laboratoire Associé au CNRS n°258, dirigé par le Professeur Lamotte. Jean-Jacques Geoffroy fut recruté au CNRS en 1981. Irène Garay fut recrutée au CNRS, en 1982 ; affectée au Laboratoire de Biologie Végétale de Fontainebleau, sous la direction de Jorge P. Cancela da Fonseca, elle continua ses recherches à Foljuif. Nos activités furent soutenues par des crédits propres de l’ENS, attribués à la Station, par des moyens du LA 258, par un contrat du ministère de l’environnement et du cadre de vie (1977-1979), par le Programme de Recherches Interdisciplinaires en Environnent du CNRS (PIREN) (1981-1983), et par l’Action Thématique Programmée du CNRS « Fonctionnement des Ecosystèmes Forestiers » (1982-1983 : projet « Étude du fonctionnement d’écosystèmes forestiers feuillus modifiés par l’homme : équilibre des populations animales et biodynamiques des humus », coordonné par François Toutain, Maître de Recherches au CNRS, Centre de Pédologie Biologique de Nancy).
Ma nomination au Muséum, en 1988, mis fin à l’équipe de Foljuif, dont certains membres poursuivirent cependant des recherches à la Station. La Direction de l’ENS ayant maintenu ma responsabilité jusqu’en mai 1993, j’y ai encore dirigé deux thèses (J. Leclerc, 1990 ; J. M. Luce, 1995). Au Laboratoire d’Écologie Générale du Muséum, à Brunoy, j’ai retrouvé une équipe de longue date spécialisée dans l’écologie des sols forestiers tempérés. Un crédit de l’ONF fut l’occasion d’engager une nouvelle recherche sur l’évolution du système-sol associée au cycle sylvogénétique dans les réserves intégrales (Publication 155). L’un de mes collègues, Pierre Arpin, organisa en outre un ouvrage collectif sur la diversité des invertébrés forestiers, publié par l’ONF, auquel j’ai participé, plus particulièrement pour le chapitre consacré à la gestion de la biodiversité (Publication1 67).
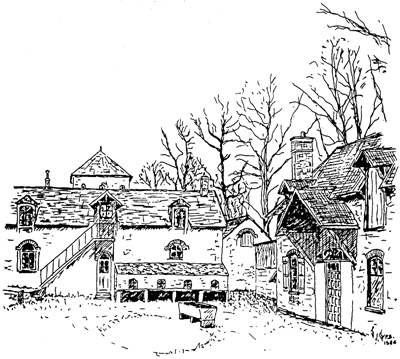
Pour en savoir plus sur la Station Biologique de Foljuif
- ANONYME, 1972.- Le Château de Foljuif, annexe de l’Ecole normale supérieure. Saint-Pierre Actualités, n°3, février 1972 : 2-3. (Publication de la municipalité de Saint-Pierre-lès-Nemours).
- ANONYME, 1973.- Ecole normale supérieure, station biologique de Foljuif. Saint-Pierre Actualités, n°12, novembre 1973 : 4-5.
- Publication 77
- Publication 106
- LAHOREAU, G., 2008.- L’environnement à l’ENS. La Station Biologique de Foljuif, un « héritage » méconnu de Maxime Lamotte. L’Archicube, 4 : 106-111.
Des premiers pas aux bioindicateurs de piétinement en forêt périurbaine
En 1977, j’obtins un financement du ministère de l’environnement pour étudier la possibilité de définir des bioindicateurs de l’impact du piétinement dans les forêts urbaines. Le travail fut mené d’une part en forêt de Montmorency, d’autre part en forêt de Fontainebleau, vers les gorges d’Apremont. Il donna lieu à un rapport rendu en 1981, et à deux articles de vulgarisation (Publications64, 69, 74). La comparaison qualitative et quantitative des arthropodes du sol dans des zones piétinées à des degrés divers permis de mettre en évidence des modifications importantes, qui traduisaient des différences de sensibilité des différents groupes d’arthropodes (Publications 59, 60). Ces résultats permettaient d’envisager la construction d’indicateurs numériques susceptibles de rendre compte de l’intensité des perturbations engendrées par le piétinement Cefut l’occasion d’engager une réflexion sur la notion d’indicateur biologique (Publication 68), qui me valut d’être sollicité par le ministère de l’environnement pour établir une synthèse sur les connaissances sur les bioindicateurs (Publication 86)
Le projet PIREN « forêts périurbaines » : première tentative d’interdisciplinarité
Dans notre rapport sur la recherche d’indicateurs de la perturbation des sols forestiers, nous avions situé la problématique dans le cadre de l’accroissement de la fréquentation des forêts périurbaines. Une étudiante, géographe de formation, avait notamment travaillé sur l’évolution de l’urbanisation autour de la forêt de Montmorency. C’est peut-être en raison de cette ébauche d’interdisciplinarité que je fus contacté, en 1980, par le Professeur Jean-Claude Lefeuvre, au nom du nouveau Programme de Recherches Interdisciplinaires en Environnement du CNRS (le « PIREN »), pour étudier la faisabilité d’un Observatoire des changements sociologiques, économiques et écologiques relatifs aux forêts périurbaines. Avec l’accord de la Direction scientifique de l’ENS, je m’associais avec Jean-Louis Fabiani, enseignant de sociologie à l’ENS.
Nous avions pour mission de mobiliser et d’associer le plus possible d’équipes de divers établissements : ENS, Universités, Muséum National d’Histoire Naturelle, Institut National de la Recherche Agronomique (INRA). En particulier, il fallait impliquer une équipe de l’INRA travaillant sur la biologie du Chevreuil en forêt de Rambouillet, et une autre, basée à Orléans, menant des recherches socio-économiques sur le massif forestier d’Orléans. Finalement, des équipes aux préoccupations fort diverses acceptèrent de participer. Le projet de faisabilité fut remis en septembre 1980. Acceptée et financée par le PIREN, avec un soutien de l’Office National des Forêts, l’opération fonctionna de 1981 à 1983 inclus.
L’équipe de Foljuif s’impliqua plus spécialement dans la problématique de l’impact du piétinement, en développant une approche expérimentale, à laquelle participèrent des chercheurs du laboratoire d’Ecologie Générale du Muséum. L’expérimentation donna d’intéressants résultats dans la perspective de la mise au point de bioindicateurs (thèses d’Eugénie Flogaitis, 1982 et de Line Nataf, 1983 ; GARAY & NATAF, 1982 ; Publications78, 86 ; ROBIN & GEOFFROY, 1985).
Dans le cadre de l’analyse des usages des forêts périurbaines, Jean-Louis Fabiani s’intéressa à l’évolution de la chasse « rurale », de plus en plus pratiquée par des urbains (FABIANI, 1983 ; voir aussi FABIANI, 1985), et Geneviève Humbert – recrutée par l’ENS pour participer aux recherches et m’appuyer au plan administratif – prépara une thèse de droit de l’environnement, soutenue en 1987, consacrée notamment à l’analyse des délits commis en forêt de Fontainebleau (HUMBERT, 1985, 1987, 1988 a, b).
Le projet initial du PIREN avait été de faire émerger une dynamique à long terme, impliquée par le concept « d’observatoire des changements », et de faire travailler ensemble des chercheurs de disciplines différentes, pour que se construise une démarche interdisciplinaire. Mais très vite, l’objectif du long terme fut abandonné, et le partage de quelques moyens financiers entre des équipes souvent sans « désir d’interdisciplinarité » ne pouvait à lui seul conduire à la construction d’une réelle démarche interdisciplinaire. Obligé d’assembler un patchwork (des lichens bioindicateurs de pollution à la dynamique de population du Chevreuil, en passant par la sociologie de la chasse, le piétinement, les délits forestiers, etc.), il me fut bien difficile, avec Jean-Louis Fabiani, de construire une « synthèse », tentée dans un rapport (Publication76) et présentée lors d’un colloque de restitution (Publication 81). Le projet ne fut pas reconduit. Un « échec » instructif, car il me fit beaucoup réfléchir à l’interdisciplinarité, d’autant que le sociologue Marcel Jollivet, qui avait suivi notre projet à la Direction du PIREN, m’invita en 1986 à participer au groupe de travail qu’il a animé pour réaliser un ouvrage sur l’interdisciplinarité, publié en 1992, aux Éditions du C.N.R.S., sous le titre Entre Nature et Société, les passeurs de frontière (Publications 122, 123).
Les batailles de Fontainebleau
Je reprends l’expression « les batailles de Fontainebleau » du livre « L’Angoisse de l’An 2000 » (publié en 1973), un recueil de textes écrits tout au long de sa carrière par le Professeur Roger Heim, ancien directeur du Muséum National d’Histoire Naturelle et ancien Président de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Roger Heim s’est en effet impliqué pour la défense du massif de Fontainebleau, comme en témoignent plusieurs de ses écrits.
« Batailles », cela évoque les oppositions au tracé de l’autoroute du sud, aux prospections pétrolières… Cela évoque, un siècle plus tôt, les peintres de Barbizon s’opposant aux forestiers planteurs de pins sylvestres… Cela évoque, il y a à peine 15 ans, les éco-guerriers, réclamant sans douceur la création d’un parc national…
Je n’ai pas l’intention de retracer la longue histoire des combats pour la conservation de la nature dans le massif de Fontainebleau. Olivier Nougarède, chercheur à l’Institut National de la Recherche Agronomique, en a dressé un remarquable tableau à l’occasion d’un colloque qui s’est tenu le 7 avril 2010, organisé par la Réserve de Biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais et la municipalité d’Avon, commune du massif de Fontainebleau. Ce colloque posait la question de la faisabilité d’un parc national à Fontainebleau.
J’ai été invité à ce colloque, pour y donner un témoignage personnel, ayant été impliqué dans certaines des dernières batailles. Je fus notamment le rapporteur de la commission présidée par le Professeur Jean Dorst en 1989-90. Mon intervention a été retranscrite et publiée (malheureusement sans m’avoir été soumise pour relecture… tant pis pour le style) sur le site de la Réserve de Biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais . J’ai expliqué pourquoi j’ai pris position, fin 2009, pour un parc national, après avoir été longtemps réticent vis-à-vis d’une telle création et avoir suggéré, avec Jean Dorst, celle d’une réserve de biosphère du programme Man And Biosphere de l’UNESCO. Nous avions exprimé la conviction que, sans implication concrète des acteurs locaux, la conservation du patrimoine naturel a peu de chances de réussir. La participation des populations locales, c’est là « l’esprit » même des réserves de biosphère. Avec la nouvelle loi (2006) sur les parcs nationaux, qui introduit la notion de solidarité écologique, cette dimension participative s’impose : la voie est ouverte à une implication des acteurs locaux bien plus grande que ne le permettait la loi précédente.
En 2010, un comité de pilotage, présidé par François Letourneux, alors Président du Comité français de l’UICN, et rassemblant des élus locaux, des représentants des usagers et des scientifiques, a débattu des questions suivantes: un parc national à Fontainebleau est-il faisable ? Utile ? Souhaitable ? Le rapport a été remis à la ministre de l’écologie en février 2011. Un consensus a été obtenu pour que la réflexion aille de l’avant dans le cadre d’un Groupement d’Intérêt Public. Consensus en trompe-l’oeil ? La position de l’Association des Amis de la Forêt de Fontainebleau, exprimée dans les annexes du rapport, est limpide : le parc national n’est ni utile ni souhaitable. Dans sa publication « La Feuille Verte », livraison de décembre 2010, l’Association s’en explique (Télécharger le PDF). Elle souligne que sa position reflète celle de la majorité des représentants d’usagers… A l’inverse, le groupe de scientifiques du comité de pilotage a répondu « oui » aux trois questions.
Bénéficier de la forêt le plus largement possible, avec le minimum de contraintes, que l’on soit simple promeneur, varappeur, chasseur à courre, est-ce compatible avec une protection efficace d’un monde vivant d’une diversité exceptionnelle, ou nous trouvons-nous face à un irréductible conflit de valeurs, qui continuera de provoquer de belles batailles ?
En tout cas, comme le récapitule Olivier Nougarède, à la suite de la remise du rapport Dorst, le 3 avril 1990, des choses ont bougé. Une directive du ministre de l’Agriculture de mars 1991 a lancé la préparation d’un nouvel aménagement de la forêt domaniale. Dans ce cadre, une étude fut commandée au laboratoire d’Ecologie générale du Muséum, en vue de caractériser les écosystèmes rares et remarquables de la forêt domaniale. Ce travail, effectué en particulier par Jean-Marie Luce, au titre du laboratoire, et par Philippe Bruneau de Miré, au titre de l’Association des Naturalistes de la Vallée du Loing, a contribué à la désignation de nouvelles réserves biologiques. Il en est résulté un accroissement important des réserves intégrales ou dirigées, d’à peine plus de 400ha à 1800 ha. Le nouvel aménagement a été promulgué en 2004. Toujours en 1991, le gouvernement a lancé une procédure de classement du massif en forêt de protection, achevée en 2002. Enfin, l’idée de créer une réserve de biosphère fut reprise par le directeur régional de l’Office National des Forêts, Yves Richer de Forges. Porté par Jacques Lecomte, alors président du Comité Man And Biosphere France, le dossier aboutit à la création de la réserve, par l’UNESCO, à la fin de 1998, dans le contexte de la célébration du cinquantenaire de la fondation de l’UICN à Fontainebleau. Après une lente mise en route, la réserve a été renouvelée à l’échéance des ses 10 premières années.
Un parc national, ce n’est pas incompatible avec une réserve de biosphère. Des exemples le prouvent. Il vaudrait cependant mieux que les périmètres soient les mêmes, ou que l’un (la réserve de biosphère ?) englobe totalement l’autre. En tout état de cause, la réussite dépendra d’une volonté politique forte, soutenue par l’adhésion d’un maximum d’acteurs à un projet commun, ce qui ne se peut qu’au prix de concessions réciproques faites sans regret. Cela suppose que les acteurs se retrouvent autour de valeurs partagées, ce qui appelle des échanges approfondis, l’abandon de postures figées, un cheminement dans le respect des valeurs dont chacun est porteur. La Réserve de Biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais ne pourrait-elle prendre la responsabilité de lancer une telle démarche, dans la logique de l’Initiative pour une Éthique de la Biosphère, promue par l’UICN ?